Canton de Montereau-Fault-Yonne
Varennes-sur-Seine
1) La Dame blanche en forme de tombeau inconnu (apparition de dame blanche et destin tragique)
Esmans
2)Les fées du Trou Cahotte (Trésor de fées)
Barbey
3)Le diable venu de Hallstatt (Trésor du Fossé d'Enfer)
Esmans
2)Les fées du Trou Cahotte (Trésor de fées)
Barbey
3)Le diable venu de Hallstatt (Trésor du Fossé d'Enfer)
Galeries mystérieuses et mythe du souterrain de communication à grande distance
4)Divers exemples du mythe du souterrain (Thoury Férottes, La Tombe, Dormelles, Nanteau-sur-Lunain, Moret, Gouaix, Nonville, Saint-Fargeau, Coulommiers)
Canton de Mormant
Guignes-Vitry
5) Sainte Anne, une experte en prodiges de réputation mondiale (Légende de la Fontaine Sainte-Anne de Vitry)
Yèbles
6) Flambettes et enchantements à la Mare des Ardents (Légende de la Mare des Ardents selon René Morel)
Andrezel
7) Cryptozoologie, version Seine-et-Marne (Mares au Diable et Mares aux Bêtes)
Canton du Châtelet-en-Brie
Féricy
Canton du Châtelet-en-Brie
Féricy
8) L’abîme qui marchait aux cloches d'église (La Mare de l’Abîme de la Forêt de Barbeau)
9) La maternité des ondes (Légende de la fontaine sainte-Osmane)
Valence-en-Brie
10) La mécanique du Diable (Légende du Gouffre de Valence)
Machault
11)Le trésor de la cabane du Diable(Légende de trésor diabolique)
Canton de Perthes-en-Gâtinais
Arbonne-la-Forêt
12) l'Abime au trésor (Légende de l’abîme du Ru de la Fontaine)
Canton de Villiers-Saint-Georges
Louan-Villegruis-Fontaine
13) Histoire de trésor caché sur fond de Pierre aux Cents Têtes (Légende du trésor de Montaiguillon et la Pierre aux Cents Têtes)
Canton de Donnemarie-Dontilly
Gurcy-le-Châtel
14)Fermé avant d’avoir eut le temps de dire ouf ! (Trésor du château de la Motte de Chalautre-la-Reposte)
Lizines
15)Il y a pas moins de 260 longues années de ça (Le trésor de la Butte des Rochottes)
Vimpelles
16)Du pognon dans les sous-sol (Le trésor du Fief d'Heurtebise)
Thénisy
17) Les trois soleils de Thénisy : ou la chasse au trésor programmée (Le trésor de la Cave Gilette)
Egligny
18) Doublon (Le trésor de l'abbaye de Preuilly)
Canton de la Ferté Sous Jouarre
Pierre-Levée
19) Le trésor de Minuit (Trésor du village de Pierre-Levée)
Canton de Tournan-en-Brie
Chaumes-en-Brie
20)Encore une histoire de chercheur de trésors qui finit mal (Trésor du manoir de Cresnes)
Canton de la Ferté Gaucher
Chartronges
21)Miscellanées et structures diverses pour trésor unique (Trésor du site de Grandchamp)
Canton de Savigny-le-Temple
Savigny-le-Temple
22)La vie aquatique à Savigny-le-Temple/ 1865-2013 (Le trésor de la Fontaine Saint-Hilier)
Canton de Rebais
Rebais
23)La cave et l'ombre d'un pâle évangile (Le trésor du Bois de la Grange)
Canton de Roissy-en-Brie
Roissy-en-Brie
24)De ce que contient la tour du roi (Le trésor de Notre-Dame-du-Cormier)
9) La maternité des ondes (Légende de la fontaine sainte-Osmane)
Valence-en-Brie
10) La mécanique du Diable (Légende du Gouffre de Valence)
Machault
11)Le trésor de la cabane du Diable(Légende de trésor diabolique)
Canton de Perthes-en-Gâtinais
Arbonne-la-Forêt
12) l'Abime au trésor (Légende de l’abîme du Ru de la Fontaine)
Canton de Villiers-Saint-Georges
Louan-Villegruis-Fontaine
13) Histoire de trésor caché sur fond de Pierre aux Cents Têtes (Légende du trésor de Montaiguillon et la Pierre aux Cents Têtes)
Canton de Donnemarie-Dontilly
Gurcy-le-Châtel
14)Fermé avant d’avoir eut le temps de dire ouf ! (Trésor du château de la Motte de Chalautre-la-Reposte)
Lizines
15)Il y a pas moins de 260 longues années de ça (Le trésor de la Butte des Rochottes)
Vimpelles
16)Du pognon dans les sous-sol (Le trésor du Fief d'Heurtebise)
Thénisy
17) Les trois soleils de Thénisy : ou la chasse au trésor programmée (Le trésor de la Cave Gilette)
Egligny
18) Doublon (Le trésor de l'abbaye de Preuilly)
Canton de la Ferté Sous Jouarre
Pierre-Levée
19) Le trésor de Minuit (Trésor du village de Pierre-Levée)
Canton de Tournan-en-Brie
Chaumes-en-Brie
20)Encore une histoire de chercheur de trésors qui finit mal (Trésor du manoir de Cresnes)
Canton de la Ferté Gaucher
Chartronges
21)Miscellanées et structures diverses pour trésor unique (Trésor du site de Grandchamp)
Canton de Savigny-le-Temple
Savigny-le-Temple
22)La vie aquatique à Savigny-le-Temple/ 1865-2013 (Le trésor de la Fontaine Saint-Hilier)
Canton de Rebais
Rebais
23)La cave et l'ombre d'un pâle évangile (Le trésor du Bois de la Grange)
Canton de Roissy-en-Brie
Roissy-en-Brie
24)De ce que contient la tour du roi (Le trésor de Notre-Dame-du-Cormier)
Canton de Montereau-Fault-Yonne
La Dame blanche en forme de tombeau inconnu
Au cours de l’année 1986, une Dame Blanche s’est manifestée à un adolescent de 16 ans et également à plusieurs personnes avant lui aux abords de Varennes-Sur-Seine. Mais c’est seulement de ce garçon dont nous allons parler à présent, car seul son témoignage m’est parvenu.
« Quand cette histoire commence, il fait nuit. L’évènement se situe soit dans la soirée, soit tôt le matin. C’est au choix. Ce dont on est sûr, c’est qu’il fait nuit. Quittant Moret notre ado, monté sur sa mobylette a emprunté la Nationale 6 en direction de Montereau. Puis, après avoir avalé la grande descente de la Vallée Jarrie, a bifurqué sur la gauche et remonté la Départementale 28a, dite Grande Rue, censée le conduire à Varennes. C’est là que les choses se compliquent. Arrivé à quelques mètres de l’embranchement avec le Chemin des Aulnettes, sa bécane lui fait défaut et s’arrête subitement. Il tente de remettre le contact. En vain, la mobylette ne veut plus rien savoir. Il sait que ce n’est pas une panne d’essence, il a fait le plein le matin-même, alors il attend quelques secondes, histoire de reposer le moteur. Fouillant les environs du regard, il aperçoit soudain une silhouette qui se tient au niveau du carrefour. C’est marrant, car il jurerait qu’une seconde plutôt, il n’y avait personne à cet endroit. La silhouette est celle d’une femme habillée d’une robe blanche. Elle porte un voile sur le visage et un chapeau. Elle a quelque chose de vaporeux, de transparent. Il n’y a pas de vent, mais sa robe ondule comme si c’était le cas. L’apparition restera sur place environ dix minutes avant de disparaître. C’est seulement à partir de cet instant que la mobylette acceptera de redémarrer et que le jeune homme pourra repartir. Le lendemain il reviendra sur les lieux en compagnie de son frère et ils fouilleront les alentours. Ils découvriront alors un « tombeau », dans les bois qui bordent la départementale, à peu de distance de la jonction avec le Chemin des Aulnettes, là où est apparue la Dame Blanche ».
 |
| CARREFOUR DE LA DAME BLANCHE (VARENNES-SUR-SEINE) |
Un dernier truc : l’adolescent s’est tué en moto quelques temps plus tard. Certains ont pensé que la Dame Blanche lui était apparue pour le prévenir. Ce genre de mise en garde annoncée ou implicite est l’un des motifs principaux qui constituent la trame des chroniques d’auto-stoppeurs fantômes ou de Dames Blanches de la route et il n’est donc pas étonnant que l’histoire, ici, se répète.
 |
| LA PIERRE TOMBALE (VARENNES-SUR-SEINE) |
(1) Coordonnées Lambert 1 : X : 0642,277 – Y : 1074,555
Les fées du Trou Cahotte
Partant d’Esmans et descendant vers Montmachoux, à moins d’un kilomètre du
village et à droite de la route, existait autrefois, dans une pièce de terre actuellement
cultivée, une excavation assez profonde connue sous le nom de Trou Cahotte. On a dit beaucoup de
choses à propos de cet endroit : qu’il s’agissait des fondations d’une
habitation gauloise, de la partie enterrée d’une hutte, des restes d’une cave
antique, d’une entrée de souterrain, d’un puisard, d’un réservoir ou encore d’une
mare asséchée. L’explication la plus probable n’est pas si équivoque. Il
semblerait en effet que nous ayons été simplement en présence d’une petite carrière
de calcaire, ou de sable en fin d’exploitation. Mentionné sur le cadastre
Napoléonien, le Trou Cahotte devait
se situer à peu près au point suivant : X : 0647.772 / Y : 1071.269,
lieu-dit actuel : La Vallée Laurent
(autrefois Les Cahottes), parcelle 65.
Rebouché dans le premier quart du 20ème siècle, il n’en subsiste plus
aucune trace à présent.
 |
| EMPLACEMENT DU TROU CAHOTTE, CADASTRE NAPOLÉONIEN (ESMANS) |
Si on en croit la légende(1),
cette cavité était occupée par des fées laides et à l’odeur repoussante, les Cahottes. Elles vivaient là et avaient
amassé au cours des années un trésor qu’elles gardaient jour et nuit. Durant la
messe du Dimanche des Rameaux, les fées abandonnaient leur repère pour sillonner
la campagne à la poursuite des villageois attardés. On les voyait aussi à la Fontaine au Lait de Beurre, perchée au
sommet des carrières du Tertre Mauboeuf(2). C’était le seul
moment ou l’on pouvait s’emparer du trésor. Bien évidemment, il fallait le
faire avant la fin de l’office et le retour des fées, sans quoi le voleur était
bon pour demeurer le reste de l’année au fond de ce trou, et finir comme
domestique auprès de ces dames. Bizarrement, la légende ne dit pas jusqu’à quel
degré d’affection pouvait s’exprimer ses services…
 |
| FÉE CAHOTTE DU TROU DU MÊME NOM (ESMANS) |
Le diable
venu de Hallstatt
« On m’a montré à Barbey à l’angle sud d’un champ, une étendue cultivée où le blé ne
pousse pas. A cet endroit, il existait autrefois une grande fosse circulaire
qui a été rebouchée depuis de nombreuses années. On a toujours trouvé au fond
de cette fosse des morceaux de céramique, et des silex en grande quantité. Une
légende courrait aussi à propos de cette fosse. On l’appelait la Fosse ou le
Fossé d’Enfer parce que des sorciers y pratiquaient le sabbat autour d’une
croix qu’ils plantaient au fond. On raconte aussi que le diable y avait enterré
un trésor qu’il gardait précieusement »(1).
Le site dont parle Pierre V fait partie du climat actuel Le Fossé d’Enfer et se situe, d’après ses
notes, au point X : 0653.931 / Y :
1073.299, parcelle 242. Il ne reste rien de visible aujourd’hui et je n’ai
trouvé personne ayant eu vent de cette histoire.
Moyennant finance, notre rentier aurait reçu l’autorisation du
propriétaire de l’époque de faire quelques recherches. Il aurait découvert
plusieurs tessons de poterie portant des motifs linéaires et géométriques, et quelques
fragments d’outils en silex. Bien que loin d’être un spécialiste en la matière,
cette structure décrite par Pierre V, le mobilier mis à jour et les toponymes
identiques, me font penser à ceux de la fosse
Hallstattienne de l'Enfer, fouillée en 1973 à Chartrettes(2). Bien
entendu, tout cela ne reste qu’à l’état de prudente conjecture.
(1) Cahier Pierre V, date du 14/06/1949.
(2) Jacqueline Degros, Jean
Guffroy, Jacques Tarrête : La fosse hallstattienne de l'Enfer, à
Chartrettes (Seine-et-Marne.). Gallia. Tome 34 fascicule 1, 1976. pp.
57-94.
Galeries mystérieuses et mythe du souterrain de communication à grande distance
Le légendaire des souterrains, et dans une moindre mesure celui des manifestations d’esprits (Dames Blanches, fantômes, revenants) est certainement l’un des derniers à demeurer encore actif de nos jours. C’est un mythe ancien qui a su assurer sa pérennité. Lors d’une enquête de terrain, 90% des personnes interrogées n’hésiteront jamais à vous glisser une ou deux infos à propos d’un ou plusieurs souterrains, même si votre question initiale n’a rien à voir avec ça. Si vous voulez faire choux gras, branchez les gens là-dessus et vous êtes sûr de rafler la mise. Sur ce point, les témoins sont intarissables, quitte à en rajouter, histoire de crédibiliser encore plus leurs témoignages. Je suppose que l’explication vient d’un besoin de rationalité. Avec le principe du souterrain, on reste dans l’imaginaire raisonnable, l’archéologie authentique, la légende savante. Là où ça pêche, c’est plutôt du côté de l’argumentation et du descriptif. C’est à peu près à ce niveau de la conversation que les choses se gâtent. Bien souvent, en fait, pratiquement dans tous les cas, l’existence d’un souterrain de communication à grande distance revient sur le tapis. Pourtant, ce genre de galerie n’existe pas ou très peu. De plus ceux qui en parlent ne les visitent pas forcément, voir même très rarement. Ce mythe fonctionne donc essentiellement sur une logique populaire, des rumeurs ou des images de vestiges mal interprétés. Ce qui suit donne un bref aperçu des croyances actuelles dans le domaine. Je n’ai retenu que les plus caractéristiques. Bien entendu, bon nombre des souterrains évoqués n’existe pas. Quant aux mesures qu’on veut bien leur attribuer, vous l’aurez compris, elles sont bien loin de la réalité.
La Ferme de la Forteresse à Thoury Férottes abrite une cave médiévale et une glacière ruinée de 10 à 12 m de long. On raconte qu’un souterrain partirait de la Forteresse et déboucherait au lieu-dit la Cave aux Moines, qui autrefois recelait peut-être un habitat. Il s’étendrait sur plus de 2,5 km à vol d’oiseau. Il subsisterait des vestiges, des morceaux de moellons, mais il existe plus rien visiblement. On a prétendu avec erreur que la ferme appartenait aux templiers et des rumeurs de trésors cachés ont circulées. Dans l’un des champs situé à proximité, un souterrain se serait effondré et aurait entrainé un paysan avec sa charrue.
À La Grande-Paroisse, il existe une version similaire, mais plus moderne cette fois-ci. Lors de la construction d’un pavillon, une pelleteuse serait tombée dans un souterrain ou une cave dont le plafond se serait soudainement affaissé.
À La Grande-Paroisse, il existe une version similaire, mais plus moderne cette fois-ci. Lors de la construction d’un pavillon, une pelleteuse serait tombée dans un souterrain ou une cave dont le plafond se serait soudainement affaissé.
Les sous-sols de la ville de Moret sont truffés de galeries souterraines. Au moyen-âge les sorcières s’y réfugiaient pour échapper à l’église et à l’inquisition. On y a retrouvé les os de certaines d’entres-elles. Il en est de même pour les templiers, dont on aurait découvert des squelettes entiers. Alexandre-Désir Teste d'Ouet en parle dans son Orpheline de Moret :
« De longs souterrains hardiment voutés dont on a fait quelques cloaques particuliers, et où ceux qui les ont découverts n’ont point osé pénétrer ; et cependant la curiosité de tant d’autres y eut été vivement aiguillonnée. De longues chaines scellées dans les piliers ne laissaient aucun doute sur l’usage qu’on en dut faire ; des ossements humains suspendus après elles, révélaient d’épouvantables mystères ; car, pendant les cinq ou six années que dura l’instruction de leur procès, que de pauvres templiers n’eurent point l’honneur du martyre public et prisonniers dans leur propre maison y expirèrent de faim et chargés de fers ! L’aspect de leurs catacombes fit reculer ceux que le hasard y avait conduits, et d’importants documents, peut-être, sont resté ensevelis dans leurs ténèbres »(1).
A Nanteau-sur-Lunain, on croit que ce sont les romains qui ont creusé les souterrains. Plusieurs courraient encore sous le parc du château et l’un d’eux déboucherait le long de l’Allée Pavée(2) Chacun leur tour, des résistants et des soldats allemands s’y seraient cachés durant la seconde guerre mondiale. On raconte également que ce chemin qui traverse la forêt de Nanteau pour rejoindre la Départementale 225 est une ancienne voie romaine et que César et ses troupes l’auraient emprunté. D’autres souterrains partant de l’ancien château féodal iraient jusqu’à la Ferme du Fourchet et au Manoir Saint-Louis en limite de forêt à plus de trois kilomètres du village.
Dans le village de La Tombe, une nuit, en 1985, vers 4 heures du matin un grand bruit réveilla plusieurs personnes. Un poteau électrique qui se trouvait au niveau de la rue des merlerots s’était couché par terre en entrainant avec lui un amas de fils qui provoquèrent aussitôt des gerbes d’étincelles. Peu de temps après, le propriétaire, sortit de sa maison. Il semblait en proie à une panique totale. Il raconta à plusieurs voisins que sa chambre à coucher venait de disparaître soudainement dans un trou. Des témoins constatèrent les faits avec effroi : la pièce s’était belle et bien volatilisée. On fit venir des experts pour effectuer des sondages, mais on raconte qu’ils ne purent atteindre le fond de cette fameuse cavité. Elle fut rebouchée par la suite, même si, depuis, elle passe dans le village pour un abime insondable. Certains pensent également qu’un énorme et très ancien souterrain traverserait l’agglomération avant de se perdre en haut du pays. C’est de sa faute à lui si ce drame s’est produit. Il se serait effondré, entrainant avec lui une partie de la maison qui fut entièrement reconstruite un peu plus loin.
On raconte que « La commanderie de Dormelles présente un très large souterrain qui s’arrête aujourd’hui au bout de 90 mètres. Certains pensent qu’il s’agit d’un passage secret conduisant à la maison de Paley situé 10 kilomètres plus loin. Outre la distance qui semble bien longue pour un souterrain, cette thèse est douteuse dans la mesure où la présence d’une maison templière à Paley n’est pas attestée. Il semble plutôt que ces souterrains correspondent au reste d’un vaste réseau de drainage, la commanderie de Dormelles étant installée sur un terrain très humide »(3). Certains ajoutent également que cette galerie serait maçonnée en berceau et que trois cavaliers auraient put y passer de front.
J’ai interrogé Monsieur Jean Dumonthier pour savoir ce qu’il pensait de tout ça. Voici ce qu’il m’a répondu : « Il y avait bien à Dormelles une ancienne commanderie de Templiers sur la route de Ville-Saint-Jacques avec une grange et une chapelle détruites au XIXème et à 500 m de là, à Saint-Gervais, un château dont il ne reste que des tours et des communs du XVIIème, château à ne pas confondre avec la commanderie de templiers. Or dans l'ancien parc de ce château, il existe un « souterrain », ou plutôt un creusement à l'horizontal dans la falaise voûté en pierre et qui se termine dans le tuf. Ce n'est pas un souterrain, sans doute une carrière de matériaux ou une réserve. Un auteur récent a affirmé que ce « souterrain où quatre cavaliers de front pouvaient chevaucher » joignait Dormelles à Paley. Tout cela est faux, il n'y a de souterrains, ni dans un cas ni dans l'autre, mais ce livre a attiré des cars de tourisme (je les ai vus) il y a quelques années, qui pensaient pouvoir faire le parcours souterrain... en car ? »(4).
À propos du hameau de la Ronce à Dormelles, Godillon a également parlé de souterrains. Il écrit : « Ce petit hameau de quatre habitations semble avoir été une dépendance des Templiers. Les maisons sont très vieilles. Sous une terrasse, il existe des souterrains que le propriétaire n’a jamais pu approfondir. Ils devaient sans doute faire communiquer toutes ces maisons entre elles »(5).
Dans sa monographie communale, l’instituteur Thominet écrivait : « Saint-Fargeau renferme les ruines d’un ancien château du 15ème siècle qui a été la résidence de la belle Gabrielle. Il en reste encore quelques souterrains et la terrasse dominant la Seine. D’après les racontars, l’un de ces souterrains, passant sous le lit de la Seine, communiquait avec la commune de Seine-Port, sur la rive droite de ce fleuve »(6).
Il existe à Coulommiers une ancienne commanderie de Templiers. Construite au 12ème siècle, c'est l'une des mieux conservés d'Ile de France. Elle est connue pour abriter un souterrain un peu particulier : « Comme dans la plupart des monuments féodaux, la tradition locale assure qu’un souterrain établissait une communication entre le domaine des Templiers situé sur la colline du Theil et le château de la duchesse de Longueville(7) construit dans la ville même. Ce n’est là qu’une fable sur laquelle vient se greffer la légende suivante : la porte de ce souterrain était de pierre et ne s’ouvrait, dans l’église des Templiers, que le deuxième dimanche avant Pâques. De grandes indulgences étaient accordées à l’audacieux qui, ce jour-là, osait entreprendre le parcours, aller et retour, du souterrain. Mais il fallait que le trajet fût accompli pendant la durée de l’Evangile de la Passion car, s’il n’était pas de retour à l’achèvement du texte saint, la porte de pierre tournait sur ses gonds avec la rapidité de l’éclair et se refermait sur l’imprudent qui disparaissait pour toujours ! En raison de la distance il eût fallu un vainqueur de Marathon pour accomplir cet exploit. Certains Columériens qui se flattent de connaître leur histoire locale n’en persistent pas moins à parler encore aujourd’hui du fameux souterrain et de la légende qui y est attachée »(8).
(1) Alexandre-Désir Teste d'Ouet : l’Orpheline de Moret, Tome 1, Louis Rosier éditeur, Paris, 1835, p 38-39.
(2) Chemin rural de Nemours à Nanteau-sur-Lunain, dit Chemin Pavé.
(3) Ivy-Stevan Guiho : L’ordre des templiers, petite encyclopédie, l’Harmattan, 2009, p 96.
(4) Jean Dumonthier : lettre datée du 1er Juillet 2010.
(5) M. Godillon : Histoire de Dormelles, 1912, tapuscrit prêté par Mr Dumontier, p 6.
(6) Thominet : Monographie communale de Saint-Fargeau, 1878, p 4 et 5.
(7) Situé actuellement dans le Parc des Capucins. Ce château fort fut reconstruit au XVIIème siècle par Catherine de Gonzague duchesse de Longueville, et fut détruit au XVIIIème par le Duc de Luynes. Seuls demeurent aujourd’hui les pavillons des gardes et une partie de l'aile du château.
(8) Ernest Dessaint : Une légende et deux sobriquets Briards, Bulletin Folklorique d’Ile-de-France, Tome 3/4, Juillet/Décembre 1945.
Canton de Mormant
Sainte Anne, une experte en prodiges de réputation mondiale
A Guignes, et plus précisément au hameau de Vitry, à quelques pas de l’ancienne forteresse féodale, exista jusqu’à la révolution une chapelle consacrée à Sainte Anne. A l’intérieur, au-dessus de l’autel, une niche conservait une statuette de la sainte, particulièrement vénérée par la population. Pas très loin, jaillissait une source à laquelle on attribuait des vertus exceptionnelles. La Fontaine Sainte Anne. Un petit ru en partait et, courant à travers champs, alimentait un moulin situé à gauche du croisement de la rue de Paris et de la rue de Servolles. On la disait réputée pour « la guérison de la fièvre, des maux de gorge et d’yeux »(1). Elle était l’objet d’un pèlerinage important. Le 27 Juillet (Fête de Sainte Anne) et le 8 Septembre (Fête de la Nativité de la Vierge Marie), une messe était célébrée dans la chapelle, puis, le clergé et les fidèles partaient en procession en direction de la source. « Ils en faisaient plusieurs fois le tour, en chantant cantiques et litanies. Les pèlerins buvaient l’eau de la fontaine à pleins verres, et chacun apportait un vase pour en conserver jusqu’au pèlerinage suivant. De plus, ils trempaient dans une partie de la fontaine des linges, des vêtements et différents objets »(2).
 |
| LA FONTAINE SAINTE-ANNE, DESSIN DE RENÉ MOREL, 1890 (GUIGNES-VITRY) |
Tout se déroula plutôt bien jusqu’à la révolution. A partir de là, les choses se compliquèrent un peu. Pour la chapelle surtout. Elle fut vendue comme bien national à un certain conventionnel Laurent Lecointre qui la céda trois ans plus tard au citoyen Jean-Baptiste Jouzon, agent national de la municipalité de Guignes-Libre, c’est à dire le maire. L’acte mentionnait une clause pour le moins radicale : les acheteurs devaient faire disparaitre cette chapelle et la transformer en grange ou en maison habitable. Toute cette histoire commençait sérieusement à sentir le sapin. Comme prévu, les travaux débutèrent peu après. La statue de Sainte Anne fut arrachée à la chapelle « et jetée sur la place voisine où le citoyen Thomas, fermier de Vitry, lui attacha une corde au cou et voulut la faire trainer par un cheval. Mais ô prodige ! (c’est ici que commence la légende) la statue parut être clouée à terre par une force mystérieuse et invincible, et le cheval de Thomas, malgré les exhortations les plus frappantes ne put la faire avancer d’un pas… On lui adjoignit un compagnon, même impossibilité de la remuer ; Thomas lui-même se mit à tirer la corde, mais ses efforts joints à ceux des chevaux semblaient rendre la statue plus pesante, on eût dit raconta plus tard un témoin de la scène, qu’elle voulait s’enfoncer dans le sol. Thomas devenu furieux, frappa de son sabot la tête de Sainte Anne… Au même instant, il poussa un grand cri, porta la main à ses yeux et tomba à la renverse. Les assistants effrayés se portèrent à son secours ou se dispersèrent en commentant ces choses extraordinaires. On rapporte que, durant cette scène, l’eau de la fontaine devint rouge comme du sang. La statue fut abandonnée près de la chapelle qu’elle n’avait pas voulu quitter. Thomas, reconduit chez lui par sa femme et par des voisins, s’alita et devint aveugle. Pendant la nuit suivante, deux vieilles femmes du hameau vinrent prendre la statue, qui se laissa enlever sans difficulté, et la cachèrent dans une cave. Quelque années passèrent, puis par un beau jour de fête, la vénérable image fut sortie de sa cachette et porter en pompe à l’église de Guignes où on la plaça sur l’autel de la chapelle saint Bernard. Elle repose aujourd’hui dans un coin du vieux cimetière de guignes où elle a été enterrée, il y a une quarantaine d’année, croyons-nous. Mais la légende n’est pas terminée encore… Thomas fit pénitence ; il recouvra la vue grâce à l’eau de la fontaine avec laquelle il se lavait les yeux tous les jours »(3).
Morel précise qu’une dame blanche apparut « dans la nuit qui suivit la destruction de cette chapelle et la profanation de la statue de sainte Anne »(4)et continua à faire parler d’elle par la suite, car les différents bâtiments bâtis à l’emplacement de la chapelle étaient réputés hantés. « Une dame blanche y apparaissait souvent à l’heure fatidique de minuit, des bruits effrayants s’y faisaient entendre et des flammes qu’on désigna sous le nom de flambeaux de Sainte Anne y dansaient des sarabandes effrénées. Ces flammes voltigeaient aussi autour de la fontaine et sur la place du village. Les bonnes gens de Vitry ne passaient plus auprès de ce lieu redouté sans se signer dévotement, sans murmurer une prière… »(5).
Dans le courant du 19ème siècle, la Fontaine Sainte Anne fut transformée en lavoir. Son eau y est toujours aussi pure. À quelques pas, au numéro 7 de la place de Vitry, et entourée de hauts murs, se dresse le corps de maisons édifié sur l’ancienne chapelle et derrière, la villa qui le domine. Portant autrefois les noms de Villa sainte Anne et les Charmettes, elle s’appelle désormais les Charmettes d’Homélie et à l’heure où j’écris ces lignes, abrite quatre chambres d’hôtes, ainsi qu’un atelier de décoration d’intérieur. L’actuel propriétaire que j’ai rencontré, n’a jamais été importuné par une quelconque dame blanche. Du reste, il n’avait jamais eut vent de ce genre d’histoire.
 |
| LAVOIR ET SOURCE DE LA FONTAINE SAINTE-ANNE (GUIGNES-VITRY) |
 |
| LAVOIR DE LA FONTAINE SAINTE-ANNE (GUIGNES-VITRY) |
(1;2) René Morel : La
Chapelle et la Fontaine Sainte Anne de Vitry, Revue régionale Brie et
Gâtinais, n°6, Juin 1909, p 184.
(3) René
Morel : La Chapelle et la Fontaine Sainte Anne de Vitry, Revue
régionale Brie et Gâtinais, n°6, Juin 1909, p 185/186.
(4) René Morel : La Brie
Légendaire. Fées et dames blanches, Revue régionale Brie et Gâtinais, 1910,
p 236.
(5) René Morel : Chapelle
et légende de Sainte-Anne de Vitry, Almanach de Seine-et-Marne, 1890, p
198/199.
Flambettes et enchantements à la Mare des Ardents
Venant de Yèbles, sur le chemin n°4 dit de Genouilly à Champdeuil, quand vous arrivez en vue du carrefour bornant la limite de la commune, regardez vers la gauche, juste à quelques mètres dans le champ, elle est là, ou plutôt elle était là… Imaginez cinq minutes : une étendue d’eau stagnante et argileuse. De longs roseaux, des hautes herbes et des fragments de bois pourrissant. Dans un coin s’élève un arbre mort. Sur la terrasse dominant l’Yerres, au sud-ouest du village, sur le climat de Pruneloy, aux cordonnées Lambert suivantes : X : 0630,708 Y : 1103,166, elle se trouvait là.
La Mare des Ardents. Certainement une mare pas très grande. Et peut-être pas très lugubre non plus. Une mare comme il y en avait de nombreuses sur ce plateau. On en dénombre pas moins d’une cinquantaine sur les plans d’intendance de la paroisse de Yèbles, Champdeuil et Crisenoy. On trouvait, pour les plus proches de la notre: la Mare du Chêne, le Marchais aux Loups, la Mare du Poirier, la Mare de la Chaperonnerie, le Marchais Farvin, la plupart, taries par les drainages successifs à grande échelle entrepris depuis la fin du 19ème siècle, ont aujourd’hui disparues. C’est malheureusement le cas pour la Mare des Ardents, dont on suppose qu’elle aurait été asséchée dans les années 1860/80, puisqu’au moment ou René Morel en parle, c'est-à-dire vers 1893, elle n’existe déjà plus. Un détail cependant, sur le plan joint à la monographie communale de 1888, la mare est toujours visible, mais l’instituteur a très bien pu s’inspirer du cadastre napoléonien de presque 60 ans son aîné. Mais revenons à Morel. Cet ancien rédacteur de la République de Seine-et-Marne est connu pour ses écrits sur le légendaire de la Brie. Son travail de collecte et d’écriture est remarquable. Dans son domaine, il est l’auteur de référence. Un type incontournable. On pourrait même dire unique, puisque personne d’autre avant lui et après lui (excepté Lecotté à sa manière) n’a osé se frotter à la question. Reste quelques doutes quant à l’authenticité de certaines légendes qu’il aurait rapportées. D’après René-Charles Plancke, « Il ne faut pas prendre toutes ces légendes pour argent comptant, ni les croire séculaires ; il n’est pas impossible qu’elles aient été inventées de toutes pièces, entre 1890 et 1898, par René Morel, ou plus exactement, que ce conteur plein de malice et de talent, ait transposé à Guignes, des légendes recueillies ailleurs »(1).On sait que Morel avait tendance à en rajouter, mais il a habité Melun et Guignes et on peut facilement envisager qu’il ait pu recueillir sur place des légendes inédites, ce que personne avant lui n’avait fait. Dans tous les cas, l’histoire de la Mare des Ardents nous est restée. La voici, telle qu’elle a été publiée dans l’Almanach de Seine-et-Marne en 1893, expurgée de courts passages qui ne servaient pas à grand chose :
« Sur le fief de pruneloy (…) se trouvait une mare appelée la Mare aux Ardents. On sait que nos pères donnaient le nom d’ardents à de gros feux-follets qui, dans la croyance populaire, circulaient la nuit, principalement pendant les nuits de l’Avent, pour égarer les voyageurs attardés et les faire tomber dans les mares, les étangs, les fondrières ou les cours d’eau. Malheur à l’infortuné qui faisait cette dangereuse rencontre ! Attiré malgré sa volonté par la pernicieuse lumière, il suivait en courant cette lueur diabolique qui le conduisait à la mort. (…) la mare de Pruneloy avait chez les bonnes gens des environs la plus mauvaise réputation pour l’excellente raison qu’elle était peuplée d’ardents, de Flambettes et de culards… Quelques vieilles prétendaient même qu’on avait vu la Grand’ Bête s’y désaltérer et que les lavandières de nuit y lavaient parfois les langes et les cadavres de leurs innocentes victimes. (…) Plus la nuit était sombre, plus les ardents étaient contents, plus ils brillaient, plus ils dansaient, plus ils voltigeaient au-dessus des champs et des prairies qui entouraient leur retraite. Il fallait, dès qu’on en voyait un, faire le signe de la croix, puis planter bien vite son couteau en terre pour amuser l’esprit follet… et encore n’était-on pas sûr de lui échapper.
Une des légendes les plus dramatiques concernant la mare en question est celle de la belle Aude, fille d’un seigneur de Genouilly, de la belle Aude qui vivait en l’an de grâce … (il y a si longtemps de cela qu’on ne sait pas au juste à quelle époque elle vivait). Elle était si belle, si belle, racontait-on, que les lutins, les farfadets, les gnomes et les ardents eux-mêmes en étaient devenus amoureux, et elle était si pieuse, si pieuse, que le Diable faisait tout pour perdre son âme…
Un soir de décembre, un de ces vilains soirs de l’Avent où les loups-garous parcourent la campagne, comme la jeune damoiselle revenait avec sa nourrice de visiter une pauvre femme malade dans une chaumière voisine du manoir, elle aperçut tout-à-coup à quelques pas devant elle, une petite lumière bleuâtre qui montait, descendait, valsait, sautillait, tourbillonnait, s’approchait, s’éloignait… Seigneur Jésus ! s’écria la tremblante enfant, un ardent ! Nourrice, un ardent ! … mais la nourrice n’était plus là … elle aussi, elle avait vu, dans une direction opposée, une petite lumière, et elle l’avait suivie, entrainée par une force mystérieuse et invincible.
Le feu-follet fit quitter à Aude le chemin qu’elle suivait. En vain invoquait-elle tous les saints du Paradis, en vain suppliait-elle la benoite Vierge Marie de lui venir en aide… l’ardent l’attirait toujours… Les oraisons les plus efficaces, les signes de croix les plus répétés restaient sans effet… Bientôt Aude remarqua avec plus de terreur encore que le méchant follet l’entrainait du côté de la mare… Il lui faisait traverser les champs et les prés, les friches et les bois, il lui faisait franchir les haies et les fossés ; elle voulait crier, et aucun son ne pouvait sortir de sa gorge contractée, elle voulait s’arrêter, et ses pieds ne pouvaient se fixer sur le sol, elle voulait se retenir aux arbres, s’accrocher aux buissons et ses mains ne pouvaient les saisir…
Ma malheureuse enfant était arrivée au bord de la mare sinistre, toute illuminée par une multitude de flammes, les unes bleues, les autres vertes, qui semblaient l’inviter à tomber dans l’eau profonde… Subitement les flammes s’écartèrent, laissant au milieu de la mare un large espace vide. Quelques secondes s’écoulèrent, puis Aude terrifiée vit apparaitre dans cet espace une énorme boule de feu… le roi des ardents, sans doute… Il s’approcha d’elle en bondissant, et horreur ! de grands bras de flamme se détachèrent de la boule ignée et s’allongèrent vers la jeune fille dont ils entourèrent la taille. Un cri déchirant traversa l’air, on entendit le bruit sourd de la chute d’un corps dans l’eau, les ardents disparurent et d’épaisses ténèbres succédèrent à la lueur brillante qu’ils répandaient.
La légende ajoute que la belle Aude, changée en flamme et devenue reine des ardents, se servit de sa nouvelle forme pour remettre dans le bon chemin les passants égarés, pour les empêcher de tomber dans les embûches tendues par les méchants feux-follets. Malheureusement, le roi son mari, très jaloux d’elle, ne la laissait sortir que rarement. Les paysans reconnaissants lui donnèrent le nom de « Bonne Flambette»(2) ; on la reconnaissait à sa belle couleur bleu tendre et à son éclat extraordinaire.
Ici se termine ordinairement l’histoire d’Aude de Genouilly. Cependant quelques bonnes vieilles au cœur plus sensible, à l’imagination plus féconde ont jugé à propos d’ajouter ce qui suit : Le lendemain, à la pointe du jour, les serviteurs du château, à la recherche de leur damoiselle, aperçurent le corps de celle-ci flottant sur la mare, au milieu des nénuphars et des lenticules… La jeune fille paraissait dormir ; sa tête était soutenue hors de l’eau par une large feuille de nymphéa. Retirée de la mare diabolique, Aude recouvra bientôt ses sens dans les bras de son père, qui la couvrait de larmes et de baisers. La légende est muette sur le sort de la pauvre nourrice. Echappa-t-elle au danger ou périt-elle en suivant le maudit feu-follet ?... Cette dernière supposition est, hélas ! La plus vraisemblable : les ardents étaient si méchants ! »(3).
(1) René-Charles Plancke : Mormant et ses environs à la belle époque, Amattéis, 1994, p 279.
(2) Les Flambettes prenaient quelquefois la figure d’une petite vieille à longue chevelure d’argent. Elles jouaient toutes sortes de mauvais tours aux bergers qui passaient les nuits dans les champs. (Note de René Morel)
(3) René Morel : La Mare aux Ardents, Almanach de Seine et Marne, 1893, p 137 à 141.
Cryptozoologie, version Seine-et-Marne
Le plan d’intendance d’Andrezel, dressé au 18ème siècle mentionne, parmi toutes celles qui existaient sur la commune, deux autres mares à caractère légendaire. Il s’agit de la Mare à la Bête et de la Mare au Diable. Elles se situaient approximativement pour la première au lieu-dit actuel le Marchais Fleury, parcelle n°3, coordonnées Lambert X : 0635,016 ; y : 1102,632, et pour la seconde, le long de l’actuel chemin rural de Suscy à Andrezel, au lieu-dit actuel le Noir, parcelle n°6, coordonnées Lambert : X : 0633, 482 ; Y : 1101,762. Elles ont aujourd’hui disparues, victimes elles aussi des drainages intensifs du XIXème siècle. Aucune légende ne nous est parvenue, mais les noms sont suffisamment évocateurs pour que je me permette d’apporter quelques précisions supplémentaires.
Avec le Diable, pas besoin de d’avantage d’explications. Même si la tradition est perdue, on peut raisonnablement penser que ce point d’eau devait soit être hanté par lui, soit être un lieu qui entrait en communication directe avec l’enfer, ou quelque chose dans le genre. Quant à sa voisine, j’avoue que son nom me pose certains problèmes. Le manque de logique, voilà ce qui pêche. Pourquoi cette vague désignation ? Si l’animal était connu, pourquoi ne pas lui avoir donné son nom ? Les mares aux loups ne manquent pas pourtant. Mais là, c’est différent. Visiblement, la bête n’a pas été identifiée, où alors en partie, mais dans tous les cas, son identité semble en faire un être à part. Redouté et redoutable, peut-être. Sans me laisser entrainer par la théorie du complot mythologique, j’ai dans l’idée que ce patronyme pourrait désigner notre Grand’ Bête régionale. Elle a souvent trainé ses basques dans cette partie de la Seine-et-Marne et il ne serait pas étonnant qu’il s’agisse d’elle. Morel en fait plusieurs fois mention dans ses écrits. Il racontait qu’elle venait se désaltérer dans la Mare des Ardents, (Andrezel n’est pas très éloigné), et qu’elle hantait l’un des souterrains du château de Blandy-les-Tours. D’après la description qu’il en fait, ce n’était pas le genre de créature qui inspirait câlins et compagnie. Voyez par vous-même :
« Dans la Brie, on donnait volontiers à cette bête fantastique la forme d’un veau qui avait quelque chose d’un lièvre et qui ressemblait un peu à un chien. Malheur au paysan attardé qui rencontrait la Grand’ Bête ! Surtout dans les nuits de l’Avent, où elle était particulièrement dangereuse. Elle sautait sur les épaules du malheureux et le faisait courir droit à une mare ou à une rivière dans laquelle elle le précipitait. Il n’y avait qu’un moyen de lui échapper : c’était de prononcer en faisant le signe de croix, certaines paroles cabalistiques qui la mettaient en fuite »(4).
Cette spéculation vaut ce qu’elle vaut et, bien entendu, n’engage que moi. Il est tout à fait probable que nous soyons aussi en présence d’un animal tout ce qu’il y a de plus conventionnel.
Deux Mares à la Bête existaient également sur la commune de Saint-sauveur-sur-Ecole, au lieu-dit actuel La Mare la Bête, parcelle n°1, coordonnées Lambert X : 0613, 811 ; Y : 1088,648. Il n’en subsiste plus rien aujourd’hui (5). Contrairement à moi, Paul Bailly pensait que ce toponyme évoquait la Male Bête du Gâtinais, celle tuée par Gaspard de Montmorin-Saint-Hérem (6) en octobre 1655. Pourquoi pas. Il en est peut-être d’ailleurs de même pour la mare précédente.
(4) René Morel : Le souterrain aux esprits, Almanach de Seine et Marne, 1892, p 146.
(6) Paul Bailly : Toponymie en Seine-et-Marne, Amattéis, 1989, p 328, 329.
Canton du Châtelet-en-Brie
L’Abîme qui marchait aux cloches d’église
Au tout début, il y a une mare. Une mare et un abîme. Un trou abyssal dont on prétend que personne n’a jamais réussi à en atteindre le fond. Située à l’écart du village de Féricy, sur le flanc nord de la Forêt Domaniale de Barbeau, à quelques encablures de la limite de commune avec Fontaine-Le-Port, cette mare n’avait jamais vraiment fait parler d’elle. Du moins jusqu’à la révolution française. A cette époque, la tradition, encore présente dans la mémoire d’une poignée d’anciens, rapporte : « Que les anciennes cloches de l’église, enfouies en 1789, dans la « Mare de l’Abîme » et qui, envasées, n’ont jamais pu êtres récupérées, se font entendre à ceux qui se penchent au-dessus de l’onde, car elles sonnent encore pour la fête de Sainte-Osmanne (1) ».
 |
| LA MARE DE L'ABIME (FERICY) |
D’une façon plus prosaïque, « On prétend
également qu’elles furent cachées dans les caveaux de l’église. Après la
terreur, elles furent remontées pour être redescendues à nouveau, brisées et,
après de longues négociations, jetées à la seine »(2).
En réalité, « les débris ont été déposés chez le citoyen Pléau et
refondus par la suite pour en faire trois nouvelles cloches »(3).
Quant aux quatre battants et la corde qui restait à l’une d’elles, « ils
furent envoyés à l’administration municipale du Châtelet, qui a vendu 9 cordes
dont le produit a surtout servi à des amusements, notamment à acheter un violon
pour faire danser la jeunesse du pays »(4).
A part ça, c’est une jolie mare. On peut toujours la voir aujourd’hui. La Mare de l’Abîme se trouve dans un coin de clairière, en lisière de bois, au lieu-dit actuel Les Bois de Barbeaux, parcelle 169, à cheval sur la 167 et la 171, coordonnées Lambert : X : 0633,307 ; Y : 1085, 701. La laîche des marais à envahie son centre et ses berges. Son fond est tapissé d’herbes aquatiques épaisses. L’eau est claire et limpide en surface. Une certaine ambiance y règne qui ferait dire à n’importe qui ayant un tant soit peu d’accointance avec le fantastique qu’elle porte bien son nom.
(1) Roger Lecotté : Les cultes populaires dans le diocèse de Meaux, Mémoires de la fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 181.
(2,3,4) Georges Guillory : Vulaines, Samoreau, Héricy, Amattéis, 1993, p 123 et 125.
La maternité des ondes
Acheté par la commune de Féricy en 2006, rénové et entretenu régulièrement depuis cinq ans par une équipe d’une cinquantaine de bénévoles, le domaine de la Salle abrite une source, vénérée depuis, dit-on, des temps immémoriaux. Il s’agit de la Fontaine Sainte-Osmane(1). Elle non plus, n’a pas échappé à quelques travaux de réhabilitation : réfection de muret, et drainage ont contribué à embellir et conserver le site en l’état. Et c’est tant mieux. S’il y a deux escaliers pour descendre à la source, c’est parce qu’autrefois, l’un était réservé au châtelain et l’autre au curé et aux pèlerins. Aujourd’hui, on peut emprunter l’un ou l’autre indifféremment. Personne ne sera là pour vous imposer quoique ce soit. Jadis, il y avait une statue près de la source. Il n’y en a plus actuellement. Faut dire que sa fréquentation n’est plus vraiment d’actualité. Comme beaucoup de ses consœurs, cette fontaine avait des propriétés quasi magiques. Son culte était étroitement lié à la fertilité et à la maternité. Jean Vatout prétend, et il n’est pas le seul, que : « Les femmes qui désiraient devenir mères, ou celles dont le lait avait tari, recouraient à la vertu de ses eaux »(2). Elle bénéficiait d’une extrême popularité et devint un lieu de pèlerinage important. Lecotté précise : « Qu’en 1711, on venait de 28km de là pour en boire »(3).
La reine Anne d’Autriche, elle-même, mordit à l’hameçon. On raconte : « qu’elle entendit parler des merveilles de cette fontaine et qu’elle fit venir de ses eaux pour en boire et pour s'y baigner, pendant qu'on célébrait une neuvaine dans l'église de Féricy, pour obtenir du ciel le fils qu'elle demandait inutilement depuis vingt-deux ans de mariage. Quelques jours après, un orage vint en aide à la puissance des eaux de Féricy. Louis XIII était revenu à Versailles, Anne d'Autriche, au Louvre. « Au commencement de décembre 1637, le roi, dit Bussy-Rabutin, partit de Versailles pour aller coucher à Sainte-Maure, et en passant par Paris il s'arrêta au couvent de la Visitation pour y voir mademoiselle de la Fayette. Pendant qu'ils s'entretenaient ensemble, il survint un orage si considérable qu'il ne lui fut pas possible de s'en retourner à Versailles (…). II attendit que l'orage cessât, mais voyant qu'il augmentait, et que la nuit approchait, (…), il ne savait où se retirer. Guitaut, capitaine des gardes de la reine (…), lui dit que la reine était au Louvre, qu'il trouverait chez elle un souper et un logement tout préparé. Il rejeta cette proposition en disant que le temps changerait. On attendit. L'orage devint plus violent. Guitaut lui proposa derechef d'aller au Louvre. (…). Sa Majesté consentit enfin d'aller chez la reine. Guitaut y courut à toute bride pour avertir cette princesse de l'heure à laquelle le roi voulait souper. Elle donna ses ordres pour le faire servir selon ses goûts. Ils soupèrent ensemble. Le roi passa la nuit au Louvre, et, neuf mois après, Anne d'Autriche mit au monde un fils, dont la naissance inespérée causa une joie universelle à toute la France. » Ainsi furent exaucées les prières de la neuvaine de Féricy! »(4). Il semblerait toutefois que ce miracle soit rattrapé par une certaine réalité, car si l’on se réfère à la chronologie historique, la semaine supposée de la conception de Louis XIV (du 23 au 30 novembre 1637), le couple royal logeait à Saint-Germain. Aie !
C’est un peu pareil avec la légende d’Osmane de Féricy. Il ne faut pas longtemps avant de réaliser ce qui ne va pas avec elle. C’est justement qu’elle se déroule dans cette commune. La marque d’une appropriation ancienne. Ici, comme bien souvent ailleurs, la tradition locale, s’est emparé des faits de la vie de la sainte pour les transposer sur son propre territoire. Osmane, pour peu qu’elle ait existée, serait née en Irlande au 7ème siècle, aurait vécu à Saint-Brieuc, puis dans la Sarthe où elle serait morte sans se douter que son nom serait donné plus tard à un village du pays(5). Comme on le voit, Féricy n’est pas tout près. Je vous rapporte tout de même la légende telle que l’a résumée Roger Lecotté, et ce sera tout pour ce chapitre : « Osmane était fille d’un roi d’Irlande, en l’an 118 ( ?), elle refusa le mariage car elle était secrètement convertie. Elle s’enfuit en France près de St-Brieuc. Là, elle s’informa où elle pourrait rejoindre Saint-Denis, on lui indiqua Paris. Elle suivit la Loire pour s’y rendre et, ayant fait beaucoup de chemin, elle se trouva un jour dans un pays couvert de forêts où elle résolut de prendre la retraite (Féricy). Avec sa servante, elle bâtit un abri de feuillage et mena une existence austère. Un jour, un jeune seigneur des environs, chassant un sanglier, la bête se réfugia près de la sainte, alors en prières près de la fontaine (Fontaine sainte-Osmanne à Féricy). Malgré les cris des veneurs, les chiens ne pouvaient bouger et le seigneur, voulant tuer le sanglier, demeura figé ; il injuria Osmane qu’il prit pour une enchanteresse et se retira. Passant à Sens, il raconta le fait à St Savinien qui se rendit auprès de la solitaire et la reconnut comme une croyante. Aussi il la baptisa avec l’eau de la fontaine et lui donna le nom d’Osmane. Pour subvenir à ses besoins, il laissa auprès d’elle un jardinier pour cultiver la terre et lui bâtir un oratoire (qui serait la chapelle de l’église de Féricy). Le bruit de sa sainteté se répandit partout et de nombreux fidèles vinrent lui demander soulagement de leurs maux. Elle rendit la vue à des aveugles. Son jardinier s’étant épris d’elle et lui ayant fait des propositions déshonnêtes, il devint aveugle et muet et n’obtint sa guérison qu’après s’être repenti. Elle guérit aussi une jeune fille malade de la gorge, rendit la vue à une enfant espagnol. Après une vie édifiante, elle mourut et fut enterrée en son oratoire où les miracles continuèrent, particulièrement pour les femmes désirant obtenir nombreuse lignée »(6).
(1) Coordonnées Lambert X : 0634, 262 ; Y : 1084, 449.
(2) Jean Vatout : Souvenirs historiques des résidences royales de France, Palais de Fontainebleau, Paris, 1837, p 315.
(3) Roger Lecotté : Les cultes populaires dans le diocèse de Meaux, Mémoires de la fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 181
(4) Jean Vatout : Souvenirs historiques des résidences royales de France, Palais de Fontainebleau, Paris, 1837, p 315/317.
(5) 72120 Sainte-Osmane.
(6) Roger Lecotté : Les cultes populaires dans le diocèse de Meaux, Mémoires de la fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 181
La mécanique du Diable
En géologie, un
gouffre est généralement une cavité calcaire, creusée sous l’action de l’eau et
dont l'entrée s'ouvre dans le sol, à l’inverse d’une caverne dont l’ouverture
se situe dans une paroi. Il y a plusieurs gouffres de ce type à
Valence-en-Brie, mais parmi les quatre que l’on peut trouver, un seul nous
intéresse. Il fait l’objet d’une légende un peu particulière. On en reparlera
en temps voulu.
 |
| INTERIEUR DU GOUFFRE DE VALENCE (VALENCE-EN-BRIE) |
Cette cavité
ne porte pas de nom remarquable. On l’appelle seulement le Gouffre ou parfois le Gouffre
de Valence. Il se situe au Nord-est du village(1), pas
très loin de la voie ferrée et de l’autoroute, au bord d’un petit bois embusqué
au fond de la Vallée Javot. L’aspect
de ce gouffre est aujourd’hui assez surprenant, comme une sorte de mécanique naturelle
ou d’entrée de mine abandonnée. Des plaques de désensablage et des poutres ont
été placés le long de ces différentes parois, peut-être pour renforcer l’ensemble,
et une dernière a été placée pour couvrir l’entrée. Tout cet assemblage
métallique lui donne un design industriel qui n’est pas sans rappeler le décor
d’un film de SF post-apocalyptique.
 |
| EXTERIEUR DU GOUFFRE DE VALENCE (VALENCE-EN-BRIE) |
 |
| RUINES DU MOULIN CISTERCIEN (VALENCE-EN-BRIE) |
Voici ce qu’il se disait encore à la fin des Trente Glorieuses :
« Celui qui se trouverait auprès du Gouffre de Valence pendant que sonnent les cloches de la messe, le dimanche de la Passion, verrait le Diable sortir de ce trou, accompagné de tous les damnés du pays, mais seulement le temps de la sonnerie des cloches »(5).
(1). Cordonnées Lambert: X ; 0641, 562/ Y : 1083, 042, lieu-dit : les Carrières, parcelle 11.
(2) Daniel Bullot
& Danielle Bullot : Le
déversoir d'un moulin à eau se perdant dans un gouffre à Valence-en-Brie
(Seine-et-Marne), Bulletin du Groupement archéologique de Seine-et-Marne,
n° 43, 2002, pp 91-98.
(3) Voir le site : http://ckzone.org/Sujet-Gouffres-et-aqueducs-en-sud-seine-et-marne.html.
(4) Paul Malherbe : Expérience sur les relations souterraines
entre la vallée Javot (Valence-en-Brie) et la source de Nanchon
(Vernou-sur-Seine), Bulletin de l’ANVL, volume 5-2, 1922, p 55.
(5) Cosette
Khndzorian-Iablokoff : Le canton
du Chatelet-en-Brie et ses environs immédiats, BSMF, n°XC, Juillet/Septembre
1973, p 85.
Le trésor de la cabane du Diable
Mr Daniel C, m’a fait parvenir ce message le 11.04.2011 :
« Sur la commune
de Machault, au lieu-dit L’Enfer, se
trouvait naguère une maison. Un homme seul y habitait. Il était plus ou moins
sorcier et on l’accusait de fricoter avec le Diable. A sa mort, la maison
demeura inhabitée et finit par tomber en ruine. La nuit on apercevait des
lueurs à travers les vestiges. Le diable y séjournait souvent et on voyait
aussi un gros chat noir, un chien, un mouton noir et parfois un bouc aux yeux
rouges rôder dans les environs. Des petits êtres difformes habitaient à cet
endroit. Ils accompagnaient le diable dans ses virées nocturnes.
On avait coutume de
racontait dans le village que sous la maison existait une cave qui renfermait
une énorme barrique remplie de pièces d’or et de pierres précieuses gardée par
le diable. Il avait jeté sur ce trésor un charme qui empêchait quiconque de
s’en emparer. Il y avait toutefois un moyen simple de déjouer cette magie: Il
suffisait, à la seconde où on l’apercevait le trésor pour la première fois, de
lancer dans la barrique un couteau préalablement consacré, ce qui rompait
immédiatement le sortilège. De plus, la trappe de la cave ne s’ouvrait qu’une
fois par an, le jour de la Toussaint, et le Diable, qui veillait jalousement
sur ses richesses, les dissimulaient sous un tas d’immondices afin que l’intérêt
et le désir des hommes ne soient pas éveillés. De cette façon, celui qui s’en
approchait ne distinguait rien d’autre que des bouts de bois et des blocs de
pierres, des excréments et des monceaux d’ordures.
Un jour, il y a très
longtemps de cela, un homme eu connaissance du trésor du Diable et du moyen
d’en prendre possession. Il se rendit donc sur place, le vendredi de la
Toussaint, trouva la cave ouverte, descendit et commença à déblayer les
détritus qui s’y trouvaient. Après des heures de labeur, il finit par tomber
sur la barrique remplie d’or. L’homme avait dans sa poche un couteau béni spécialement
à l’église de Saint-Vincent de Machault, mais lorsqu’il voulut le sortir, son
doigt rencontra malencontreusement la lame et il se coupa. La douleur lui fit
retirer la main. Il était trop tard. Le trésor se changea aussitôt en une
multitude d’insectes et de serpents qui épouvantèrent le pauvre homme et le mirent en fuite.
On raconte que depuis cette époque, plusieurs personnes tentèrent leur
chance, sans plus de succès. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune trace de la
maison et de la cave. Quant au trésor du
Diable, seul ce dernier sait ce qu’il a pu devenir…».
L’Enfer. Les
cadastres Napoléonien et contemporain situent ce lieu-dit au sud-sud-est de
Machault, point X : 0637.062 / Y : 1082.655. Actuellement, c’est une
longue parcelle de terre cultivée, partiellement boisée au nord. Deux bosquets
isolés sont séparés de moins de 100m. Je n’ai trouvé aucun document sur la
maison dont parle Mr Chailloux et, si elle a un jour existée, il n’en reste plus
aucun vestige aujourd’hui. Que ce soit dans les deux bosquets, ou dans les
champs alentours. D’après lui, c’était sûrement une bâtisse très ancienne,
peut-être même une cabane construite sur les vestiges d’une cave antique. Du
côté du hameau de Villers circulaient d’ailleurs des histoires sur des
improbables camps et fossés de César(1), mais
ce genre de tradition n’a rien d’exceptionnel et surtout, n’est pas en mesure
d’attester quoique ce soit ailleurs.
 |
| LA CABANE DU DIABLE (MACHAULT) |
Canton de Perthes-en-Gâtinais
L’abîme au trésor
Un étrange problème se rencontre avec l’abîme du Ru
de la Fontaine d’Arbonne, à Arbonne-la-Forêt. Là encore, si le ru existe
toujours, l’abime a bel et bien disparu. Lorsque j’y suis allé au mois de
Juillet 2012, le lavoir, supposé être alimenté par cette source, était à sec. Le
ruisseau reprenait son cours un peu plus loin pour se poursuivre jusqu’à
l’autoroute A6, où il est alors redirigé dans un petit chenal en direction des Marais de Baudelut. Si on en croit le
cadastre, l’abime devait peut-être se situer au bout du Chemin Rural, dit de l’Abime. Pourtant, rien aujourd’hui ne fait
penser qu’il ait pu exister un tel gouffre. La profondeur du Ru de la Fontaine n’excède pas 20 cm, et
la largeur de ses rives se maintient d’un bout à l’autre, sans variation
importante.
 |
| L'ABIME, PLAN D'INTENDANCE DU 18EME (ARBONNE-LA-FORET) |
Il existe une
légende à propos de cet abime. Je l’ai gardée pour la fin, car elle n’est pas
sans rapport avec le prochain thème de mon étude consacrée aux légendes et aux
traditions de Seine-et-Marne. Je vous
laisse deviner…
« Autrefois il y avait un abime dans le ru de
la fontaine d’Arbonne. Il y a longtemps un seigneur, sa dame et ses gens
auraient été engloutis avec leur carrosse dans ce trou abyssal alors qu’ils
fuyaient Fontainebleau. On raconte qu’ils avaient avec eux un coffre rempli
d’or. Celui qui se tenait près de l’abime durant le jour de la Toussaint
pouvait entendre le galop des chevaux et voir les fantômes des noyés sortir de
l’eau et faire le tour des champs alentours. On prétend que durant cette
période, on pouvait s’emparer du trésor resté dans le carrosse. Mais il fallait
le faire avant le retour du seigneur et de sa dame et l’abime était considéré
comme n’ayant pas n’ayant pas de fond »(1).
Canton de Villiers-Saint-Georges
Histoire de trésor caché sur fond de
Pierre aux Cents Têtes
On la repère en moins de cinq minutes dans le Bois de Montaiguillon, au bord de la
Départementale 131. L’un des derniers exemples d’architecture médiévale et
militaire du bassin parisien encore debout et plutôt en bon état. Une imposante
forteresse en ruine qui à le privilège de n’avoir jamais été totalement restaurée,
peut-être bricolée de temps à autre et parfois entretenue pour les besoins du
moment, mais jamais de manière durable. Une première fois démantelée vers 1421,
puis remise au goût du jour peu de temps après, elle fut de nouveau démolie vers
1613 sous les ordres du cardinal Richelieu qui n’aurait pas fait cinq minutes
au poste de conservateur du patrimoine. Laissée à l’abandon depuis presque 400
ans, la basse cour, dans laquelle un petit corps de ferme a fait récemment l’objet
de rénovation, est parfois squattée par des inconnus durant des périodes plus
ou moins longues. Aux abords immédiats et dans les parties les plus reculées,
la végétation s’est confortablement installée. Les douves et la contrescarpe
disparaissent sous un rideau vert quasiment impraticable. Happé par le lierre,
les tours paraissent réduites de moitié.
 |
| TOUR DU CHÂTEAU DE MONTAIGUILLON (LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE) |
Les lieux ont toujours fait l’objet de redoutables superstitions.
Des ogres y avaient établi leurs quartiers, notamment dans un souterrain
« qui se prolongerait sur une
distance de plus de 20 kilomètres et communiquerait avec la citadelle de
Provins »(1). René Morel prétend que l’endroit « passait pour servir de retraite à des hommes
qui mangeaient les jeunes gens »(2). Quelques
années auparavant, l’instituteur Chonot, rapportait les choses de manière plus conventionnelle,
mais tout aussi décalée, et affirmait avec erreur(3), qu’une
fois le château devenue propriété des Templiers, « ces chevaliers y commirent toutes sortes d’orgies. On les accusait même
de se repaître de la chair humaine des nouveau-nés. Attaqués par ordre du roi,
ces cannibales, après avoir supporté un siège de plusieurs années furent pris
et condamnés à être étranglés »(4). Pourtant
ce qui, au cours des siècles, avait fait la réputation de ces ruines et qui
attirait les curieux tout autant qu’il les rebutait était la présence d’un
trésor caché. Les plus optimistes se persuadaient qu’il était enterré sous
l’une des plus grosses tours du château, et qu’il avait été planqué là par un
quelconque seigneur au temps des croisades, de la guerre de cent ans ou même
beaucoup plus tard. Pour les moins drôles « que ce manoir était habité par le Diable qui y avait entassé des
trésors dans une cave dont la porte restait ouverte le vendredi saint pendant
la lecture du grand évangile, mais dans laquelle personne n’osait
pénétrer »(5).
Jean Lefèvre ajoute que « le maréchal de Chastellux, avant de se rendre aux Anglais après le
siège de la forteresse de 1424, avait fait enfouir des sommes considérables
pour les soustraire aux pillards. Le chapelain du château les aurait mises
alors sous la garde de sainte-marguerite, à qui la chapelle seigneuriale était
dédiée. D’autres, l’accusant d’être aussi bien avec les saints du paradis
qu’avec le diable, affirmèrent que l’intervention du démon sauva seule la
mystérieuse cachette de toute recherche. Cependant chacun ignorait dans quel
endroit gisaient les coffres remplis d’or et quel était le « sésame
ouvre-toi » qui en donnerait la possession au mortel assez audacieux pour
en tenter la conquête »(6).
La légende du Trésor
de Montaiguillon a été publiée en 1910 dans les numéros 5 et 6 de la Revue Brie et Gâtinais. L’auteur,
Jean Lefèvre, explique que sa grand-mère lui a raconté cette histoire durant la
seconde moitié du 19ème siècle. Elle la tenait elle-même de son
aïeule qui avait connu le héros de ce récit véridique. Là, ça devient vraiment
intéressant. Un peu comme un truc qui ne vaut pas un clou et qui soudain se
change en or. Une autre chose aussi. Vous le remarquerez sûrement, mais les
indications de Lefèvre et de Morel divergent dès qu’ils se mettent à parler du
jour d’ouverture de la porte du souterrain. L’un évoque le dimanche, l’autre le
vendredi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce détail me paraît plutôt
poser problème, surtout pour un chasseur de trésor. Vingt-quatre heures de
différence, ça fait quand même beaucoup. En revanche, il existe une
certitude : celle de l’évangile. La tradition veut qu’on lise le récit de
la passion le Dimanche des Rameaux et
également le Vendredi saint, même si ce
n'est pas le même texte à chaque fois. En effet, durant le premier on a le
choix entre la passion selon Saint-Mathieu, Saint-Marc ou Saint-Luc, suivant
l’année correspondante, et durant le second, uniquement la passion selon Saint-Jean.
Cela ne résout pourtant pas le désaccord entre nos deux informateurs et, tout à
fait entre-nous, ce n’est pas un cas exceptionnel. Une erreur de ce type n’est
pas plus invraisemblable ici qu’une vérité ailleurs. Plus important, vous ne
devez pas oublier que nous parlons de légendaire. Les descriptions qui en résultent
ont toutes les chances d’êtres parfois contestables ou incohérentes.
Quant au texte de la légende, celui-ci se prolongeant sur presque dix pages,
je préfère en donner ici une version raccourcie. L’action se situe à Louan, aux
alentours de 1752/53 :
« Un soir de mars
qu’il pleuvait à torrents, Jean Moinot entendit heurter rudement à sa porte.
Quittant le maigre feu auprès duquel il se chauffait, il alla ouvrir en
maugréant.
- Tiens !
s’écria-t-il à la vue de la silhouette qui se dessina dans l’entrebâillement de
l’huis, c’est Triconet. Qu’est-ce que tu viens faire au village aussi tard, par
ce temps de chien ?
- Es-tu seul ?
lui demanda-t-on à mi-voix.
- Oui.
- Alors personne ne
m’aura vu entrer ici, dit le nouvel arrivant. Il faut que tu me caches jusqu’à
l’aube. La maréchaussée est à ma recherche et je ne veux pas être pris !
- Ah ! mais ça,
c’est autre chose, répondit Moinot.
Pendant ce rapide
colloque, Triconet avait fermé la porte et, s’appuyant contre elle, il parut respirer
plus à l’aise, et aussi plus rassuré. Triconet était, pour le moment, berger à
Champcouelle près de Villiers-Saint-Georges. Il avait la réputation d’être un
des sorciers les plus redoutables de la région, car on le disait héritier des
secrets de son congénère Hocque, dont la mémoire était encore vivace dans la
contrée, bien qu’étant passé de vie à trépas, 60 ans auparavant. On lui
attribuait le pouvoir de jeter des sorts aux bêtes et aux gens. Un geste, un
coup d’œil suffisaient pour cela. Si ses talents professionnels et
extra-professionnels lui avaient permis de rendre des services et d’avoir droit
à la gratitude de ses obligés, il est probable qu’il abusa aussi de son
prestige, car sur une dénonciation faite contre lui à la Prévôté de Provins, la
force publique s’était mise à sa recherche. Plusieurs fois, il avait été utile
à Jean Moinot, il avait compté sur sa reconnaissance et était venu frapper à sa
porte. Cependant Moinot demeurait atterré, donner asile à un tel homme, cela
sentait singulièrement la corde !
- On ne sait pas que
je suis ici, dit le fugitif, tu ne risques rien. Laisse-moi donc me reposer un
peu et je repars. Foi de Triconet, je te revaudrai cela.
Moinot se laissa
convaincre et Triconet alla se cacher dans le fenil. Le lendemain, au petit
jour, il sortit discrètement de son refuge et avant de s’éloigner, appela son
hôte et lui dit :
- Si je suis pris,
c’est la potence. Je veux te laisser un secret dont tu feras ton profit :
tu seras riche ! Il ne faut qu’oser et cela n’engage en rien ton salut
éternel, écoute ! Et il l’entretint mystérieusement du trésor du château
de Montaiguillon et du moyen de s’en emparer. La chose était des plus
simples : il ne s’agissait que de trouver dans la muraille supportant
autrefois le pont-levis, une pierre assez grande qui fermait l’entrée du
souterrain conduisant au trésor. Mais il
était inutile de vouloir la forcer car elle n’était pas visible en temps
ordinaire. On ne pouvait se rendre compte de son existence que le dimanche des Rameaux,
à l’heure de la Grand’Messe et seulement pendant la durée de l’Evangile de la
Passion.
Au moment où le curé
de Louan en commençait la lecture, la pierre qui était évidemment fée, tournait
sur des pivots invisibles, elle démasquait un escalier étroit qui s’enfonçait
et conduisait à une salle voutée renfermant des coffres remplis d’or.
Seulement, celui qui tentait cette aventure devait être agile, car, outre que
l’ouverture ne restait béante pendant le temps indiqué, l’escalier ne comptait
pas moins de 365 marches. Et rien au monde n’aurait pu faire rouvrir l’entrée
enchantée une fois close. L’imprudent qui se serait laissé enfermer en aurait
été quitte pour attendre à l’année suivante que la liberté lui fut rendue.
Naturellement, Moinot
se garda bien d’entretenir sa femme de ses projets. Il aurait eu tout le
village pour l’accompagner dans son entreprise. Ce n’est pas qu’il devint déjà
avare, mais il considérait les richesses en perspective comme étant sa
propriété et il préférait en rester le maitre.
Donc, le dimanche des
Rameaux, de l’an 1752, il expliqua à sa femme Marie-Anne, qu’il avait besoin
d’aller visiter un des champs qu’il cultivait à la lisière des bois. Moinot
avait bien calculé le temps nécessaire pour effectuer des recherches sérieuses.
Il était sur l’emplacement désigné juste au moment où l’Evangile commençait à
être lu dans l’église paroissiale. Il remarqua pourtant un gros buisson de
ronces qui cachait le pied de la muraille. Il l’éventra d’un coup de bâton et
vit qu’un trou béant s’ouvrait devant lui. L’escalier était là. Il hésita un
instant, puis entra. Les ténèbres se refermèrent sur lui. Il eut peur et
ressortit aussitôt. A peine eut-il touché le seuil, qu’il se sentit poussé en
avant et, par un phénomène singulier, il ne put plus bouger. Il se retourna.
L’ouverture était refermée ! et un pan de sa souquenille était pris dans les
joints de pierres. L’Evangile de la Passion était terminé !
Avec son couteau, il
découpa l’étoffe et regagna le logis, ruminant une nouvelle expédition pour
l’année suivante.
*
- Cela ne fait
rien : je reviendrai…
Et d’un pas alerte, il
gravit les degrés glissants, en forçant dans les endroits difficiles pour faire
passer les parties de son vêtement qui frottaient contre les murs suintants. Il
finit par arriver en haut de l’escalier. La lumière du jour lui sembla
merveilleuse. Encore un pas et il était dehors ; mais au moment où il
allait le faire, la pierre servant de porte tourna sur elle-même et boucha
l’ouverture.
Il était
enfermé ! Le curé de Louan avait terminé son Evangile un quart de minute
trop tôt ! Toutes les peines qu’il prit pour remuer le grès énorme qui
l’emmurait, furent vaines. Terrifié, perdant la tête, il vida ses poches et en
jeta à pleines autour de lui le contenu. Ayant ainsi allégé sa conscience par
cette restitution, il supplia qu’on le laissa sortir. Mais rien ne répondit à
sa prière, rien que le bruit monotone d’une goutte d’eau tombant quelque part
avec une lente cadence. Cette résonnance cristalline lui sembla être le tic tac
d’une mystérieuse horloge, mesurant la marche lente des siècles passant sous
ces voutes antiques et ténébreuses. Bientôt sa chandelle s’éteignit, brulée
jusqu’au bout ; alors il perdit tout sentiment…
Un flot de lumière
vint baigner son visage et il reprit ses sens. La porte enchantée était de
nouveau ouverte. Moinot recouvra aussitôt la mémoire. En un bond, il fut dehors.
Les ronces qu’il avait écartées tout à l’heure avaient diablement repoussé. A
l’aide de son bâton, il fit une trouée et s’éloigna. Il s’arrêta un peu plus
loin pour s’étirer avec volupté
- Bonne sainte
Vierge ! je l’ai échappé belle se dit-il en frémissant. Si jamais on m’y
reprend !..
Et il s’achemina vers
Louan, dont l’unique cloche sonnait à toute volée.
- Quoi ?
pensait-il, la messe finit seulement ? Il me semble pourtant que j’ai
rudement dormi là-dedans.
Etonné, il pressa le
pas et des gouttes de sueur ne tardèrent pas à perler sur son front. D’un geste
machinal, il les essuya avec sa manche. Il s’arrêta stupéfait. Sa barbe qu’il
portait courte d’habitude, était devenue aussi longue que celle d’un
patriarche. Mais sa surprise grandit encore à quelques pas de là. Il traversait
justement un champ cultivé par lui. Son étonnement fut grand quand, à la place
du blé qu’il avait planté, il vit une petite jachère où la petite Toinon
faisait paître ses deux moutons. Il héla la fillette et tomba des nues en
constatant que la gamine de quinze ans, opulente comme un échalas quarante-huit
heures auparavant, était devenue une belle jeune fille.
- Toinon ! lui
cria Moinot, peux-tu me dire ce que tout cela veut dire ?
Et comme, il faisait
un geste désespéré, la jeune fille poussa un cri d’effroi et se sauva à travers
champ.
- Est-ce qu’elle a
perdue la tête ? murmura-t-il en continuant son chemin.
A l’entrée du village,
il aperçut la mère Petit qui, appuyée sur son bâton, marchait péniblement dans
son jardin.
- Elle est
terriblement cassée depuis hier, remarqua-t-il. Elle était encore droite. Eh
bien, la mère, ça ne va donc pas ce matin ?
La vieille le regarda
un instant, puis rentra aussi vite qu’elle le put, dans sa chaumière, en
marmottant des paroles qu’il n’entendit pas. Alors il fut saisi d’une angoisse
inexprimable. Tout ceci n’était pas naturel. A cette idée, il se mit à courir
vers sa maison, comme s’il avait eu le diable à ses trousses. Quand il pénétra
dans sa cour, il ne remarqua rien d’extraordinaire. La porte de sa demeure était
ouverte ; du seuil, il aperçut sa femme qui rentrée de l’église, défaisait
son beau casaquin des jours de fêtes. Au bruit de ses pas, Marie-Anne se
retourna, le toisa d’un regard hostile et avant qu’il eut ouvert la bouche,
elle l’arrêta net par cette étrange bienvenue :
- Holà, le pautrain,
il n’y a rien pour vous ici ; quand il n’y a plus d’homme dans la maison,
la maie est vide !
Du coup, Moinot en
laissa tomber son bâton.
- Allons, ma mie, tu
ne vois donc pas… tenta-t-il de dire.
Sa moitié était une
femme de décision ; aussi empoigna-t-elle un solide gourdin, et,
menaçante, se mit en devoir d’expulser l’intrus.
Ace moment, le vieux
chien Marquis, vint prendre part à l’action. Il s’élança sur Moinot, mais en
gémissant après lui, lui léchant les mains et le visage.
- Lui me reconnait, au
moins, s’exclama le malheureux en fondant en larmes et en serrant l’animal contre
sa poitrine. Alors Marie-Anne interdite par cet étrange spectacle, le regarda
attentivement et laissa tomber sa trique en disant :
- Ah ! mon
Dieu ! Ah Jésus ! mais on dirait mon homme !
Et voilà comment
Moinot, nouvel Ulysse, fut reconnu par son chien avant de l’être par sa femme.
Enfin, il put raconter son histoire et apprit que c’était pendant une année
entière qu’il avait dormi dans le souterrain de Montaiguillon. Ceci expliquait
tout ce qu’il lui était arrivé depuis sa délivrance.
Marie-Anne, trop
heureuse d’avoir retrouvé son mari, ne lui fit aucun reproche, car si elle
était d’abord rude, elle ne l’en aimait pas moins de tout son cœur. Moinot
avait bien un regret : celui d’avoir vidé ses poches complètement. Mais
quant à recommencer une nouvelle excursion dans l’antre diabolique, ah !
il avait la chair de poule rien que d’y penser.
A partir de ce jour,
il laboura ses champs avec plus d’ardeur, et si les écus qu’il en tira ne
gonflèrent point ses poches au point de l’empêcher de franchir la porte de sa
maison, au moins ils furent de bon aloi, lui permirent de résister à la dureté
des temps et de nourrir la famille qui leur vint.
Ma grand-mère qui m’a
raconté cette histoire, terminait toujours par cette conclusion : «
Rappelle-toi, mon enfant, que l’argent le mieux retenu par nos mains est celui
provenant de notre travail »(7).
*
Un autre monument, tout aussi célèbre que la forteresse de
Montaiguillon se trouve également sur la commune de Louan. Quelque part, il
semble indissociable de ces ruines. On verra à la fin, pourquoi.
Même s’il a été souvent été qualifié de menhir ou de dolmen
par différents auteurs(8), nous
avons affaire cette fois-ci qu’à un simple rocher naturel dont la désignation
rappelle à coup sûr une ancienne tradition légendaire. La Pierre aux cent têtes. C’est son nom. A l’heure où j’écris, il n’y
a aucune explication valable sur son origine. Lemarteleur et Doublet sont les
seuls à proposer un semblant d’interprétation : « Il se pourrait que, primitivement comme
plusieurs pierres du même genre, la roche fût connue sous le nom de
« Pierre Folle » ; de là, la dénomination Pierre-sans-Tête et
par corruption de Pierre-aux-Cent-Têtes »(9). Pourquoi
pas. De la même manière, et puisqu’on a parfois cru qu’il s’agissait d’une
pierre de sacrifice, Pierre-au-Sang-Tête
pourrait tout aussi bien convenir.
Elle est située dans les Bois
de Montaiguillon, lieu-dit la Fosse
du Taux, à moins de deux km à l’ouest de l’ancien château et sur le point
le plus haut de la commune, 207 m(10). C’est la dernière d’une enfilade de trois roches
plus ou moins imposantes. Toutes sont des formations gréseuses identiques,
formant des empilements ou des agglomérats de plaques ou de blocs, de taille et
de poids différents. Celle qui nous intéresse est un amas de quatre énormes grès
empilées deux par deux et formant comme un début de jeu de construction. La concernant, trois idées tenaces semblent
avoir parcourues les siècles pour venir jusqu’à nous. La première est qu’il
s’agit d’une pierre branlante, la deuxième qu’elle ai été bâtie par nos celtes
indigènes et la troisième qu’elle ai pu, par la même occasion, servir de lieu
de culte aux druides et d’autel sacrificiel. Comme bien souvent dans ces cas là,
une petite visite sur place s’impose toujours, histoire de vérifier ce qu’il en
est réellement. Je m’y suis rendu en compagnie de Mr René H, de Louan qui
connaît bien les lieux et l’histoire de sa région. Ce dernier a toujours
entendu raconter que l’on pouvait facilement faire remuer l’un des blocs, mais
il n’a jamais pu y parvenir et il ne se rappelle pas que quelqu’un ai pu le
faire en sa présence ou non. Pourtant d’après Bourquelot elle était :
« capable de tourner avec une
extrême facilité sous la simple pression du doigt d'un enfant »(11).
L’abbé Puyo(12) qui lui consacre un long
article sans finalement vraiment en parler et l’instituteur Chonot, pour ne
citer qu’eux, sont aussi d’accord sur ce point : il s’agit bien d’une
pierre « qu’on peut faire osciller
facilement »(13). La
tradition elle-aussi n’en démord pas, pourtant cette démarche, opérée par mon
informateur et moi n’a jamais pu aboutir. Il a fallut me rendre à
l’évidence : nous avons été incapables de faire bouger quoique ce soit. Mr
H avait finalement raison. Cela signifie-t-il que cette pierre n’a jamais pu
être actionnée ? Pas sûr, d’autant que nos précédents auteurs semblent
convaincus par leurs propos. L’endroit précis où s’exerçait la pression a-t-il
finalement été oublié ? A-t-on stabilisé la roche à une époque
indéterminée pour l’empêcher de bouger ? L’église y est-elle pour quelque
chose ? Tout ça me paraît plutôt délicat à démêler.
 |
| LA PIERRE AUX CENTS TÊTES (LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE) |
Quant aux théories soutenant que ce monument pouvait avoir
été édifié par les celtes et utilisé par les druides, tout le monde sait qu’aujourd’hui,
ce genre d’idées est à prendre avec un certain recul, voir même avec pas de
recul du tout. Il n’y a que dans la tradition ancienne, l’Almanach(14) et
le Patrimoine des communes de la
Seine-et-Marne(15), les
sites internet touristiques ou encore ceux de la mairie de Louan que cette opinion
courre toujours. Bourquelot et l’abbé Puyo ont fait ce qu’il devait faire, mais
en dépit de l’importance de leur témoignage, il est à peu près certain que les
celtes n’ont rien à voir avec l’agencement si particulier de ce bloc qui n’est finalement
qu’une simple formation naturelle. Parallèlement, il n’y a aucune certitude non
plus, et encore moins de preuves, qu’ils aient utilisé cette roche à des fins
cultuelles ou sanglantes.
Ce n’est pas tout. Vers 1919, Jules et Jean Camille Formigé,
tous deux architectes, ont imaginé que le site de la Pierre aux Cent Têtes pouvait avoir été autrefois le foyer d’une
arène antique. Voici ce qu’ils en disent : « Du reste cette disposition générale d’un lieu où une foule se
rassemblait pour jouir d’un spectacle était connue des gaulois avant l’arrivée
des Romains. On en a retrouvé des exemples qui nous sont parvenus et qui
devaient servir pour des cérémonies religieuses ou des assemblées
politiques : l’un d’eux présente au centre une construction mégalithique
longue d’une dizaine de mètres et faisant face à un vaste hémicycle en terre.
Le monument correspond à la scène, l’hémicycle aux gradins et l’espace qui les
sépare à l’arène ». Et précisent : « A Montaiguillon (S-et-M), dans les grands bois qui dépendaient de l’ancien
château de Villenauxe. Le monument mégalithique porte le nom de pierre aux cent
têtes dont le sens est éclairci par la connaissance que nous avons de
l’étymologie de nom de Vercingétorix »(16). A
mon avis et au regard de leur description, Jules et JC n’ont jamais mis un pied
dans les Bois de Montaiguillon, ou
alors ils ont l’imagination drôlement fertile. Même constat avec Vercingétorix,
dont on a dit quelque fois qu’il était le Grand
Chef des Cent Têtes(17). Là encore, j’ai
le sentiment qu’ils poussent le bouchon un peu loin.
Un autre témoignage, un peu confus à mon sens, mérite quand
même d’être signalé : « Il y a
quelques siècles à peine, au château de Montaiguillon, près de Villenauxe
(Aube), il y avait un monument, la Pierre aux cent têtes, dont les bases
subsistent encore. D’après une légende, à la nativité de Saint-Jean-Baptiste,
laquelle correspond au solstice d’été, sur l’ordre des prêtres, un rideau de
verdure tombait : le soleil, pénétrant alors dans l’édifice, l’éclairait
d’une manière particulière, possible seulement ce jour-là dans l’année »(18).
Comme je le disais au début, il existe un lien entre cette
roche et les ruines de la forteresse. Il consiste en quelques mots trouvés dans
les écrits de René Morel et Paul Bailly. Même si on peut difficilement faire
mieux question laconisme, il me semble néanmoins important de les replacer dans
leur contexte. Une précision toutefois : aucune tradition orale ne les
atteste et je me demande si le second ne s’est pas inspiré du premier en ajoutant
quelques éléments de son cru, d’autant qu’il ne me semble pas très sûr de son
coup (menhir, sans doute).
Voici ce que disent René Morel en 1895 et Paul Bailly
en 1989 : « Les gnomes dansent
sur la Pierre aux Cent Têtes »(19) et
« La Pierre aux Cent Têtes, à
Fontaine-sous-Montaiguillon, menhir (sic) qui passe pour être le refuge de
gnomes rouges monstrueux qui gardent, sans doute, le trésor du château »(20).
Pour finir, un poème trouvé
sur site exemplaire de la commune de Rieux dans la marne. Je le répète encore,
la Pierre aux cent têtes n’est pas un
DOLMEN !!!!
LE DOLMEN DE MONTAIGUILLON
Sur un coteau boisé, non loin d'un fort castel,
Où le taillis de chêne est ouvert en clairière,
Se dresse un haut dolmen en trois blocs de meulière
Qui fut aux temps anciens soit tombeau, soit autel.
Un berger à l'entour fait paître son cheptel,
Parfois trouve une flèche en silex sous le lierre,
Mais ne demande pas s'il survit dans la pierre
L'âme d'un vieux héros qu'on promut Immortel.
Ce noble mégalithe est dit : " pierre à cent têtes ";
Étrange et vain surnom. Quelles barbares fêtes
Croit-on qu'on célébrait au pied de ce dolmen ?
" Pierre à santé " vaut mieux: à l'esprit qui l'habite
Le fiévreux, le perclus, venait rendre visite,
Et l'épouse vouait le fruit de son hymen(21).
Sur un coteau boisé, non loin d'un fort castel,
Où le taillis de chêne est ouvert en clairière,
Se dresse un haut dolmen en trois blocs de meulière
Qui fut aux temps anciens soit tombeau, soit autel.
Un berger à l'entour fait paître son cheptel,
Parfois trouve une flèche en silex sous le lierre,
Mais ne demande pas s'il survit dans la pierre
L'âme d'un vieux héros qu'on promut Immortel.
Ce noble mégalithe est dit : " pierre à cent têtes ";
Étrange et vain surnom. Quelles barbares fêtes
Croit-on qu'on célébrait au pied de ce dolmen ?
" Pierre à santé " vaut mieux: à l'esprit qui l'habite
Le fiévreux, le perclus, venait rendre visite,
Et l'épouse vouait le fruit de son hymen(21).
(1) Chonot : Monographie de la commune
et de l’école de Louan, 1888, ADSM p 34.
(2)René Morel : Les apparitions du
château de Blandy, le souterrain aux esprits, Almanach de Seine-et-Marne, 1892,
p145.
(3) Théodore
Lhuillier : Fontaine-sous-Montaiguillon,
Almanach de Seine-et-Marne, 1898, p 139.
(4) Chonot : Monographie de la commune
et de l’école de Louan, 1888, ADSM p 35.
(5) René Morel : Les apparitions du
château de Blandy, le souterrain aux esprits, Almanach de Seine-et-Marne, 1892,
p145.
(6) Jean Lefèvre : Le trésor de Montaiguillon, Revue Brie
et Gâtinais, n°5, Mai 1910, p 173.
(7) Jean Lefèvre : Le trésor de Montaiguillon, Revue Brie
et Gâtinais, n°5, Mai 1910, p 169/173 et
n°6, Juin 1910, p 204/207.
(8) Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris, 1880, p 89, Roger Lecotté :
Les cultes populaires dans le diocèse de Meaux, Mémoires de la
fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 122, Paul Bailly : Toponymie en Seine-et-Marne, Amattéis, 1989, p 335, différents
sites internet : atome77, Brionautes.com, Genea77,
et une ancienne carte postale qui mentionne l’ensemble du site sous le non
de : Dolmens du Bois de
Montaiguillon.
(9)Edmond Lemarteleur et Robert Doublet :
Le folklore préhistorique dans le sud du
département de la Marne : Revue de Folklore Français, Tome 4, 1933, p
177.
(10) Coordonnées Lambert I : X 0683.961
Y 1104.158.
(11) Félix
Bourquelot : Histoire de Provins,
Volume 1, Lebeau, 1839, p 31.
(12)Abbé Puyo : La Pierre-à-Cent-Têtes
du Bois de Montaiguillon, étude sur les pierres druidiques branlantes, Société
d'Archéologie, Sciences, Lettres et Arts du Département de Seine-et-Marne,
Melun, 1865.
(13) Instituteur Chonot : Monographie
de la commune et de l’école de Louan, 1888, p 5.
(14) Théodore Lhuillier : Fontaine-sous-Montaiguillon, Almanach de
Seine-et-Marne, 1898, p 142.
(15) Patrimoine des communes de la Seine-et-Marne, Flohic éditions, 2001, Tome
2, p 1476.
(16) Jules et Jean-Camille Formigé : Les arènes de Lutèce, Paris, imprimerie
municipale, 1919, p 8.
(17) Camille Jullian : Vercingétorix, Hachette, 1903.
(18) Edouard Fourdrignier : L’éclairage des grottes paléolithiques
devant la tradition des monuments anciens, Revue de l’Ecole d’Anthropologie
de Paris, 1906, p 336.
(19) René Morel : La Brie légendaire, Notre Département, n°3, 1988, 21.
(20)Paul Bailly : Toponymie en Seine-et-Marne, Amattéis, 1989, p 335
Canton de Donnemarie-Dontilly
Fermé avant d’avoir eut le temps de dire
ouf !
Le château féodal de la Motte (ou Mothe), dont les ruines
sont bien connues des habitants de Chalautre-la-Reposte,
fut certainement bâti sur un édifice plus ancien dont on a réutilisé les
soubassements(1). Autrefois motte castrale
plantée au milieu de marécages, il fut détruit et reconstruit à plusieurs
reprises, avant d’être une dernière fois, et en grande partie, démantelé, dans
le courant du 18ème siècle par son propriétaire du moment, M. de
Brichanteau, qui utilisa les pierres pour construire un modeste manoir(2).
 |
| RUINES DU CHÂTEAU DE LA MOTTE (GURCY-LE-CHATEL) |
Ce qui reste de ce château se
trouve au milieu d’un bosquet, au point : X : 0656.410 / Y :
1086.549, à quelques dizaines de mètres du chemin de Gurcy à
Donnemarie-Dontilly et servant de limite avec cette dernière commune. Plusieurs
platanes gigantesques se dressent autour du tertre sur lequel subsistent d’importants
vestiges. Les pans de murs encore debout, hauts de 4m environ, forment un grand
arc de cercle s’étendant d’Est en Ouest et sont percés de plusieurs ouvertures.
Sur les parois, le lierre semble avoir fusionné avec les pierres et le mortier
en une étrange composition fossile. Coup de chance, une tour, curieusement
épargnée par le temps et le vandalisme humain, est encore en place.
Une légende(3), qui
ne semble pas avoir survécu dans beaucoup de mémoires, se rattache à cette
tour et affirme qu’elle renfermerait un trésor caché là au cours du 14ème
siècle, pendant l’invasion anglaise. Une trappe située à la base de l’édifice
donnerait accès à un caveau dont le mur du fond s’ouvrirait au premier coup de
minuit le jour de Noël, et permettrait d’atteindre une seconde cavité remplie
de richesses. La tradition précise qu’il faut s’en emparer avant que retentisse
le dernier son de cloche si on ne veut pas que le passage dérobé se referme
brutalement et retienne prisonnier celui qui s’y est aventuré.
 |
| TOUR DU TRÉSOR DU CHÂTEAU DE LA MOTTE (GURCY-LE-CHATEL) |
Il y a pas moins de 260 longues années
de ça
À ma connaissance, Auguste
Lenoir, alors secrétaire de la section de Provins de la Société archéologique
de Seine-et-Marne, a été le premier à avoir mentionné par écrit la légende du Trésor des Rochottes de Lizines. Cas rare, voir quasiment
unique dans le département, si on exclut l’affaire de Vimpelles, cette
tradition est à l’origine d’un événement historique qui secoua pas mal la vie
locale de l’époque, puisqu’il donna lieu à un procès qu’on aurait pu classer en
d’autres temps de sorcellerie. Comme on s’en rendra bientôt compte, au milieu
du 18ème siècle, les affaires de la religion n’étaient toujours pas
à prendre à la légère et l’influence de l’église pesait suffisamment pour que
ce genre de drame se produise. Mais tout d’abord quelques informations d’ordre
géographique et folklorique tirées du papier de Lenoir, probablement écrit
entre 1869 et 1872 :
« A peu de distance et au sud-ouest du petit village de Lizines, que
traverse la voie romaine de Chailly à Sens, au sommet d'une légère éminence
appelée dans le pays la Butte des Rochottes, existait autrefois, si l'on en
croit la tradition, un château féodal qui portait le nom des Roches ou des
Rochottes. Quelles mains élevèrent jadis ce château, aujourd'hui disparu ?
C'est un point sur lequel la tradition ne s'explique pas. Fut-il construit sur
l'emplacement d'un établissement romain, comme le voisinage de la voie pourrait
le faire supposer, par un des seigneurs de Lizines? N'était-ce qu'une simple
forteresse isolée destinée à servir de refuge dans les temps malheureux où les
guerres civiles et religieuses désolaient la France? C'est ce qu'aucun document
écrit ne permet de reconnaître. Les gens du pays assurent qu'au moment où la
route de Coulommiers à Bray fut ouverte sur l'emplacement du perré des Romains,
quelques fouilles faites la butte des Rochottes, amenèrent la découverte de
médailles et d'objets antiques, mais ces précieuses épaves qui eussent sans
doute jeté le jour sur l'histoire ignorée et problématique du château des
Rochottes, furent disséminées à tous vents. Aujourd'hui, l'éminence dont je
parle ne présente aucun vestige de constructions anciennes. Le sol, bouleversé
par les excavations des carriers qui puisent en ce lieu des grès et du sable,
permet, jusqu'à un certain point, par sa configuration, au milieu d'une plaine
vaste, à peu de distance du chemin perré, d'adopter l'hypothèse d'une résidence
fortifiée, sorte d'avant-poste placé aux confins de la petite province du
Montois. On domine en effet de ce point tout le plateau qui s'étend depuis la
tour de Lizines jusqu'à l'imposante église de Rampillon, et depuis la grande
route de Paris à Bâle jusqu'au ravin de Cessoy, mais, nous le répétons, aucun
pan de mur n'est resté debout pour établir la valeur de notre hypothèse. Quoi
qu'il en soit, c'est une opinion bien accréditée qu'un château féodal existait
autrefois sur la butte des Rochottes, et qu'il a disparu au temps des grandes
guerres (…). Avec cette opinion admettant l'existence du château des Roches, il
en circulait une autre, plus mystérieuse, qui prétendait qu'un trésor
considérable avait été déposé dans les caves du château, lors du passage des
ennemis. On ajoutait qu'après la ruine de l'édifice, ce trésor dont l'existence
était ignorée des dévastateurs, était resté enfoui sous les décombres. Le temps
avait passé sur ces événements lointains, mais la légende du trésor des
Rochottes, restée intacte, se posait comme un problème décevant à l'imagination
populaire. On comprend ce que la découverte de ce trésor, grossi encore par la
crédulité, dut allumer de convoitise dans le cœur des habitants des villages
voisins. La butte des Rochottes devint sans doute le point de mire de tous les
ambitieux et de tous les aventuriers mais les recherches, pour être
fructueuses, ne devaient avoir lieu que dans certaines conditions, sous
certaines formes mystérieuses où se mêlaient les rites étranges de la
sorcellerie et les prières empruntées aux cérémonies religieuses. Malgré les
rigueurs de l'église et les poursuites criminelles dirigées contre ceux qui s'y
livraient, ces pratiques bizarres, ces idées superstitieuses se perpétuèrent
longtemps dans les campagnes »(1).
A la fin de son article, notre
auteur précise : « L’idée qu’un
trésor existait à la Butte des Rochottes se perpétua longtemps dans l’esprit
des gens de la contrée. Aujourd’hui encore, le climat des Rochottes est appelé
dans le pays le Climat du trésor »(2). Ce
lieu-dit occupe aujourd’hui une langue de terre cultivée d’environ 350m de long
sur 120m de large dont le plus haut point avoisine les 150m d’élévation. Elle
ne contient qu’une seule parcelle, la n°40. Ses coordonnées, prises, à peu près
au centre sont : X : 0661.182 / Y : 1091.755. Comme le disait
Lenoir, l’endroit est vide de tous vestiges, pourtant, sur une image satellite
de Google Earth, datée du 24/08/2010,
au point : X : 0661.065 / Y : 1091.745, un rectangle d’environ
40m sur 30 se détache nettement de la surface du sol. En revanche, on ne le
retrouve pas sur les autres clichés disponibles, ce qui me fait dire que tout
ça n’est peut-être qu’une mauvaise interprétation de la réalité. A surveiller
de près, donc.
On doit la légende suivante à
René Morel qui s’est grandement inspiré de l’article de Lenoir, qui déjà devait
beaucoup à François-Antoine Delettre et à son Almanach du canton de Donnemarie-en-Montois qui reproduisait en
partie la majorité des pièces du procès de Lizines conservées au greffe de
Provins.
Le récit est ici à peine
enjolivé. L’histoire de la jeune Madelon et de Gérard Moynet et la fin tragique
de ce dernier, ne sont que pures inventions de la part de leur auteur. Pour le
reste, Morel s’en est tenu aux faits historiques rapportés par Lenoir et
Delettre, allant parfois jusqu’à recopier des passages entiers, sans jamais
citer ses sources. Chacun son truc.
Voici le texte intégral de cette
légende parut dans l’Almanach de Seine-et-Marne, en 1899 et intitulé : Les Chercheurs de Trésors :
 |
| DESSIN DE RENÉ MOREL (ALMANACH DE SEINE-ET-MARNE 1899) |
« En ce temps là, c'est-à-dire en l’an de grâce 1753, vivait en la ville
de Chaumes-en-Brie, un pauvre vigneron du nom de Gérard Moynet, qui était
amoureux de la gente Madelon, l’accorte servante de l’hôtellerie
Saint-Christophe, au village de Guignes. Madelon avait le cœur sensible, et
elle ne pouvait rester indifférente aux tendres sentiments qu’elle avait
inspirés à Gérard, un bon et vigoureux gars, pauvre d’écus mais riche de force
et de jeunesse, de santé et de courage. C’était avec un plaisir bien doux
quelle recevait les compliments, qu’elle entendait les soupirs, qu’elle voyait
le sourire de son galant, mais il y en a toujours, hélas ! Madelon était
coquette, Madelon était intéressée, Madelon était ambitieuse, Madelon, enfin,
voulait devenir hôtelière, et pour cela, il lui fallait non seulement un mari,
mais encore de l’argent… De l’argent !... et le pauvre Gérard qui n’avait
que sa belle mine et son bon cœur, que sa vieille chaumière et sa petite vigne…
« Lorsque vous aurez trouvé un trésor, lui dit-elle un jour en
badinant, nous pourrons nous marier ensemble. Tenez ! Dans le pays de ma
grand’mère, à Lizines-en-Montois, il y en a un, et un fameux encore : le
trésor de la Butte-des-Rochottes ; allez le déterrer et vous reviendrez me
l’offrir ! »
Elle se moquait, mais le pauvre garçon prit la chose au sérieux, et il
jura, le téméraire ! De trouver le trésor ou de mourir…
La croyance aux trésors cachés sous les ruines des vieux châteaux était
encore à cette époque très répandues dans nos campagnes. L’un des plus célèbres
de ces mystérieux trésors se trouvait, disait-on, sous la Butte-des-Rochottes,
légère éminence située à peu de distance et au sud-ouest du village de Lizines,
aujourd’hui dans le canton de Donnemarie-en-Montois. D’après la tradition, un
manoir féodal s’élevait jadis sur cette butte, et son dernier seigneur, voulant
soustraire ses richesses aux recherches d’ennemis qui allaient s’emparer de la
forteresse, les avait cachées lui-même dans un profond souterrain qui
s’étendait sous une partie de sa demeure. Les ennemis s’étaient rendus maîtres
de la place, mais ils n’avaient pu découvrir ce trésor sur lequel s’amoncelèrent
bientôt les ruines fumantes du château. A quelle époque ces faits se
passaient-ils ? On l’ignore. Peut-être au temps désastreux où les troupes
du duc de bourgogne ravageaient le pays, pillant, tuant, brulant tout sur leur
passage, au temps où les héroïques habitants de Mons-en-Montois furent
massacrés dans la tour de leur église, ou ceux de Luisetaines et de Meigneux
furent pendus aux arbres des routes ou précipités dans les puits… Quoiqu’il en
soit, c’était une opinion bien accréditée dans la contrée qu’un château féodal
existait autrefois sur la Butte-des-Rochottes et qu’un trésor se trouvait caché
dans le souterrain que recouvrait cette butte légendaire.
Gérard Moynet partageait la croyance commune et persuadé que des
richesses fabuleuses étaient enfouies à l’endroit désignée par Madelon, il
quitta sa chaumière, il abandonna sa vigne pour aller s’établir à proximité de
la fameuse butte, dans laquelle il avait l’intention e faire des fouilles. Que
de désillusions, que de souffrances l’attendaient !... Ayant pris gite à
Bécherelles, sur la paroisse de Dontilly, à peu de distance de Lizines, il
étudia longuement sur place les moyens de découvrir ce trésor qui devait lui
donner la belle Madelon, qui devait faire de lui non pas un hôtelier, mais un
riche et puissant seigneur. Pour s’aider dans son entreprise, il s’associa
secrètement, un vieux berger de Lizines, Fiacre Serpillon, qui passait pour
sorcier. Après une étude approfondie du terrain, et certaines pratiques
superstitieuses, les deux hommes convinrent d’attendre le dimanche des Rameaux
pour mettre leur projet à exécution, l’usage voulant que les recherches de ce
genre se fissent ce jour-là, pendant la lecture, à la messe de l’évangile de la
Passion.
Donc, le dimanche des Rameaux de l’année 1753, Gérard Moynet et Fiacre
Serpillon se trouvèrent sur la Butte-des-Rochottes, à l’heure de la messe.
Leurs intentions avaient transpiré et plusieurs habitants de Lizines et de
Sognolles, les avaient suivis par curiosité. Bravement, Moynet et Serpillon se
mirent à l’œuvre, non sans avoir fait certains signes cabalistiques et récité
diverses oraisons et invocations. Mais les fouilles auxquelles ils se livrèrent
n’amenèrent aucune découverte de trésor. Au bout d’une heure d’inutiles
recherches, les deux compagnons, fatigués, déçus, mais non découragés, abandonnèrent leur travail et décidèrent de
continuer les fouilles le vendredi saint, pendant la lecture de l’évangile
selon Saint-Jean, plus efficace encore croyait-on. En voyant partir Moynet et Serpillon, les curieux
rassemblés autour d’eux se dispersèrent pour aller raconter dans le village la
scène à laquelle ils venaient d’assister.
Bientôt, le curé de Lizines apprit que deux « sorciers »
essayaient de découvrir à l’aide de maléfices le trésor de la Butte-des-Rochottes.
Fort mécontent de l’absence à l’office de plusieurs de ses paroissiens qui
avaient suivi Moynet et Serpillon, il se rendit le jour même, après vêpres, à
la butte, pour examiner les fouilles et se livrer à une enquête. Après avoir
entendu les témoins de la scène, puis « les chercheurs de trésors »,
il s’empressa de porter plainte contre Moynet et Serpillon. Dès le lendemain,
16 Avril, à la requête du procureur du roi de la Généralité de Paris au
département de Provins, les cavaliers de la maréchaussée procédèrent à
l’arrestation des deux pauvres diables qui, les mains liées et la corde au cou,
furent conduits à Provins où on les emprisonna comme des malfaiteurs dangereux.
Le surlendemain de leur incarcération, Moynet et Serpillon subirent un premier
interrogatoire devant Monsieur l’assesseur en la maréchaussée de Provins, puis
l’instruction suivit son cours, c’est-à-dire que les interrogatoires se succédèrent,
que les auditions de témoins s’accumulèrent, que chaque jour, le malheureux
Gérard et le pauvre vieux Serpillon furent tournés et retournés sur le gril de
dame Thèmis, par MM. Les juges du présidial. Tout cela finit par aboutir, le 22
août 1753, quatre mois après l’arrestation, à un jugement d’incompétence
renvoyant Gérard Moynet et Fiacre Serpillon devant M. le prévôt de Lizines. Les
infortunés !... Ils n’étaient pas encore au bout de leurs peines… M. le
prévôt de Lizines était alors Maitre Jacques Nicolas Letellier, avocat au
parlement, juge civil, criminel et de police en la prévôté et seigneurie de
Lizines, un homme qui ne plaisantait pas, avec tout ce qui touchait de près, ou
de loin, à la sorcellerie. Considérant Moynet et Serpillon comme des suppôts du
malin esprit, adonnés aux pratiques les plus criminelles de la Kabbale, le
docte magistrat se plut à leur faire subir des interrogatoires les plus
insidieux. Les plus perfides, pour leur arracher des aveux plus compromettants
les uns que les autres. Gérard Moynet, toujours interrogé le premier, et le
plus longuement en sa fâcheuse qualité de principal accusé, reconnut que le
jour des Rameaux, après avoir entendu la première messe à Savins, il avait
fouillé la terre durant plusieurs heures à la Butte-des-Rochottes, dans
l’espoir de découvrir le trésor qu’on y disait caché. Le juge lui ayant demandé
pour quel motif il avait choisit ce jour-là et l’heure de la messe pour faire
des fouilles, il répondit qu’on choisissait ce jour et cette heure parce que
« Les portes des trésors enfouis s’ouvraient d’elles-mêmes pendant la
lecture de l’évangile de la Passion ». Mr Letellier posa une foule de
questions au pauvre garçon sur « ses rapports avec le diable », car
dans l’esprit du prévôt, Satan devait avoir joué un rôle important dans toute
cette grave affaire. Moynet avait-il fait invocation au Diable pour l’appeler à
son secours ? Etait-il parvenu à le faire venir ? Etc., etc. L’accusé
jura qu’il n’avait jamais eu d’accointances avec ce dangereux personnage qu’il
ne connaissait que par la description que M. le curé de Chaumes en avait
maintes fois faite en chaire, et que son crime, si crime il y avait, consistait
tout simplement à avoir lu quelque lignes dans un petit livre que lui avait
donné un berger de Verneuil. Il ne s’était encore servi qu’une fois de ce
grimoire pour essayer de découvrir le trésor des Rochottes. « N’ayant pas
réussi le dimanche des Rameaux, ajouta naïvement le pauvre amoureux de Madelon,
je me proposais de continuer mes recherches le vendredi saint, avec l’aide de
ce petit livre, si je n’avais pas été mis en prison et si le seigneur de
Lizines, M. de Maricourt, avait voulu me le permettre. » Mais cela ne
suffisait pas au juge, qui voulait quand même voir de la magie dans les faits
reprochés aux deux accusés. Moynet devait avoir récité certaines prières
défendues et proféré quelques paroles coupables ; le malheureux s’en
défendit avec toute l’énergie qui lui restait et répondit « qu’il n’avait
récité d’autres prières que l’une de celles qui se disent à l'église le jour des Rameaux et qui
commence par ces mots : Attolite portas principes vesiras…, qu'il fit
dévotement quelques signes de croix, et qu'il ne prononça aucune parole de
malice ; du reste, continua-t-il, c'était, selon les anciens, la manière de
trouver les trésors, parce que le diable était enchaîné par la vertu de la Passion
que l'on chante, et pendant laquelle il n'a plus aucun pouvoir. Moynet ajouta
également « qu'ils avaient piqué des rameaux en terre pour en fixer les
points. » Le petit livre ou grimoire,
donné par le berger de Verneuil, saisi et déposé au greffe, fut l’objet d’un
minutieux examen, et d’un long procès-verbal de description. Ce procès-verbal
nous apprend que ce grimoire contenait six petites feuilles écrites à la main;
qu'au quatrième feuillet il y avait la
figure d'une poule noire, et sur les autres, des caractères irréguliers; que
sur les trois premières pages se trouvait une espèce de discours ou
raisonnement, en français dans les onze premières lignes, et en mauvais latin
dans le surplus, avec différentes figures de petites croix en divers endroits ;
que des invocations au démon sont écrites à la dernière page ; que la manière
de se servir de la poule noire est indiquée à la septième page. »
 |
| DESSIN DE RENÉ MOREL (ALMANACH DE SEINE-ET-MARNE 1899) |
Serpillon fut beaucoup moins tourmenté par le juge : il prétendit
qu’il n’avait jamais donné que quelques conseils à Moynet et que la curiosité
seule l’avait conduit à la Butte-des-Rochottes. Les dépositions des témoins
furent interminables. Presque tous les habitants de Lizines défilèrent devant
Mr Letellier. L’un d’eux Étienne Billet, garde-vert, déclara que la
veille des Rameaux Moynet, qu’il ne connaissait pas alors, lui avait demandé
s’il voulait l’aider à découvrir un trésor. « J’ai, lui dit le chercheur,
un livre pour conjurer le diable et je saurais bien le forcer à m’ouvrir la
porte du trésor des Rochottes. »
C’était grave !
Un autre témoin, Louis Sénard âgé de 20 ans, recteur des petites écoles
à Lizines, fit une déclaration qui n’améliora pas la position du pauvre
amoureux de Madelon, au contraire. Il déclara : « Que le dimanche des
Rameaux, après la messe, il a été requis par M. le curé de l'accompagner aux
Rochottes, afin de reconnaître et faire condamner à l'amende les personnes qui
s'étaient absentées de la messe, sous prétexte de voir des particuliers
travailler à la découverte d'un trésor, que les gens du pays disent
d'ancienneté être caché en ce lieu qu'ils ont trouvé Serpillon et Moynet qui
revenaient au village. Interrogé par M. le curé s'ils avaient trouvé le trésor,
Moynet a répondu qu'il n'avait pu le
découvrir parce que M. le curé avait chanté la Passion trop précipitamment ;
mais que s'il était libre, il y retournerait le Vendredi-Saint ; qu'il
viendrait à bout de faire sa découverte, si M. le curé mettait plus de temps à
chanter la Passion ; il ajouta qu'il avait un livre par le secours duquel il
obtiendrait le trésor ; que lorsqu'il lisait dans son livre, la terre
s'enlevait et volait dessus pour l'empêcher de lire, s'il ne se trouvait pas
placé à la bonne place (la place du trésor); mais que, arrivé dessus, la terre
s'ouvrirait d'elle-même pour donner accès dans la voûte, et faciliter
l'enlèvement du trésor ; que Moynet et Serpillon avaient apporté un sac à blé
pour emporter l'or et l'argent. »
 |
| DESSIN DE RENÉ MOREL (ALMANACH DE SEINE-ET-MARNE 1899) |
Le 5 septembre, le prévôt rendit une ordonnance par laquelle il
relaxait Fiacre Serpillon, mais maintenait la détention préventive de Gérard
Moynet, principal accusé. Le désespoir du pauvre garçon fut affreux. En vain,
il pria, il supplia le juge de lui rendre la liberté, de lui permettre de
retourner à Chaumes, jurant de renoncer à la recherche des trésors, de mener
une vie exemplaire ; il alla même jusqu’à parler de son amour pour Madelon
qui devait se désoler de son absence, pour Madelon qui allait l’oublier,
peut-être… Le prévôt se contenta de hausser les épaules et de faire signe aux
gardes d’emmener ce fou… Gérard fut reconduit à son cachot. Dans la nuit du 24
au 25 septembre, après des efforts surhumains, il réussit à briser la porte de
sa prison et à s’enfuir. On le chercha longtemps, Mr Letellier n’était pas
homme à lâcher sa proie : il mit toute la maréchaussée à ses trousses, et
le 21 février 1754, on finit pas arrêter le fugitif dans les bois de Maurevert,
proche Chaumes. Ramené devant le prévôt de Lizines, le chercheur de trésors fut
de nouveau jeté en prison et, cette fois, étroitement surveillé.
La procédure se poursuivit, longue et laborieuse (elle comprend plus de
quarante pièces) et, enfin, le 26 Mars 1754, plus d’un an après l’arrestation
des deux « sorciers », le prévôt de Lizines rendait, sur les
conclusions conformes du procureur fiscal, un jugement longuement motivé aux
termes duquel Gérard Moynet était condamné : « A être banni pour neuf
ans du ressort de la prévôté de Lizines, après avoir été mis et attaché au
carcan de la place publique dudit Lizines, pour y être exposé pendant deux
heures, ayant devant et derrière la tête un écriteau portant ces mots :
Superstitieux abusant des prières et des cérémonies de l’église… ».
En outre, le pauvre vigneron fut condamné à payer dix livres d’amende.
Plus heureux, Serpillon ne fut banni que pour trois ans et n’eut à payer que
trois livres.
Et Madelon ? Lorsque Moynet, have, épuisé se trainant à peine
revint à Guignes pour revoir Madelon, il apprit qu’elle venait d’épouser
l’hôtelier du Lion d’Or, un concurrent de Saint-Christophe, un veuf ivrogne et
brutal, mais qui avait des écus !... Le lendemain matin, la belle Madelon
en entrant sous une remise de son hôtellerie, recula effrayée et jeta un cri
perçant ; devant elle, se balançait au bout d’une corde, attachée à une
poutre, le cadavre de Gérard, le malheureux chercheur de trésors »(3).
 |
| DESSIN DE RENÉ MOREL (ALMANACH DE SEINE-ET-MARNE 1899) |
Une dernière info avant de
poursuivre : un autre lieu-dit à tradition existe sur la commune de Lizines.
Il s’agit de La Pierre Tournante(4). Situé à un peu
plus de 200m au sud du village, bordé par la D 209 et D 106, il regroupe les
parcelles 62, 75 et 63. On aperçoit aucun bloc à cet endroit. Toutefois, la
présence de ce toponyme indiquait certainement une pierre légendaire capable de
tourner sur elle-même durant une période de temps définie et à un moment bien
précis, comme par exemple pendant l’Evangile de Noël ou la Messe de Minuit.
Rencardez-vous auprès de Sébillot qui en a abondamment parlé dans son Folklore
de France. On sait également que, bien souvent, les pierres qui ont cette
faculté de virevolter ont aussi une certaine prédisposition à cacher des
trésors. Les deux sont bien souvent indissociables et n’existeraient pas sans
le concours de l’un ou de l’autre. J’imagine raisonnablement la possibilité que
cette pierre aujourd’hui disparue ait pu être le point de départ et de
diffusion de la rumeur d’un trésor enfoui. On pourrait même aller jusqu’à
supposer que la légende de la Butte des
Rochottes soit le produit de cette propagation, et, cas extrême, que la
tradition attachée à la Pierre Tournante
se soit complètement éclipsée de la mémoire collective au profit de sa voisine.
Tout ça ne serait pas nouveau.
1) Auguste Lenoir : Le Trésor des
Rochottes, Bulletin de la Société d’Archéologie du Département de
Seine-et-Marne, 6ème Volume, 1869-1872, Meaux 1873, p 207/208.
(2)Auguste Lenoir : Le Trésor des Rochottes, Bulletin
de la Société d’Archéologie du Département de Seine-et-Marne, 6ème
Volume, 1869-1872, Meaux 1873, p 306.
(3) René Morel : Histoires et
légendes de la Brie, les Chercheurs de Trésors, Almanach de Seine-et-Marne,
1899, p 180 à 190.
Du pognon dans les sous-sols
La commune de Vimpelles possède elle aussi une
tradition de trésor caché assez proche de la précédente. Elle se décline en
deux endroits différents, éloignés l’un de l’autre d’un peu plus d’un kilomètre.
Le premier qui fait office de référence incontournable, question témoignages, est
le site du fief d’Heurtebise, aujourd’hui détruit. Le second se trouve sur
l’ancien lieu-dit les Caves(1), à proximité du hameau
de Cutrelles. A propos de ce dernier, voyons ce que nous dit notre rentier-prospecteur :
« Vimpelles : cave ou souterrain renfermant le trésor des
moines de Saint-Sauveur. J’ai interrogé plusieurs habitants de Vimpelles et de Cutrelles.
Tous connaissaient la légende du trésor d’Heurtebise, mais un cultivateur de
Cutrelles m’a confié être descendu dans sa jeunesse, dans une cave qui se
trouvait à proximité du chemin de Parouzeau, à l’endroit appelé Les Caves. Elle
aurait été rebouchée depuis, car elle représentait un danger pour la culture.
D’après cet homme, il y avait un tunnel au fond de la cave, mais il n’était
plus praticable au bout d’une centaine de mètres. Ce souterrain conduisait à
une crypte où les moines du prieuré avaient caché leur argent »(2).
 |
| SOUTERRAIN (VIMPELLES) |
Je n’ai trouvé personne
aujourd’hui capable de m’en apprendre d’avantage sur cette histoire de
souterrain, qui n’est peut-être que la conséquence d’une confusion ou d’une
contamination due au mythe local. L’enquête s’arrête donc là pour le moment, ce
qui, au final, n’est déjà pas si mal. En revanche, la légende du trésor
d’Heurtebise, mentionnée une première fois en 1888 dans la monographie
communale de l’instituteur Ledan, et étroitement liée à un fait historique
avéré, semble être encore présente dans la mémoire des lieux.
 |
| EMPLACEMENT DE L'ANCIEN FIEF D'HEURTEBISE (PLAN D'INTENDANCE DE LA COMMUNE DE VIMPELLES, DOCUMENT ADSM) |
Le fief d'Heurtebise(3), de
fondation ancienne et composé autrefois d’un château-fort, d’une église, et
d’une ferme seigneuriale avaient été la propriété du couvent bénédictin de
Saint-Sauveur-les-Bray. En 1791, un certain Escalard de la Bellangerie, acheta le
domaine 63.000 livres et le laissa à sa fille Madeleine. Neuf ans plus tard, le
20 août 1800, il devint la propriété de Louise-Henriette Genest, veuve
Berthollet de Campan, qui à son tour, le vendit en 1817. Le nouvel acquéreur fit
raser le château et les bâtiments de la ferme en 1818(4). Théodore
Lhuillier rapporte en détail ce qu’il s’est produit à ce moment là :
« On n’a
peut-être pas oublié, aux environs de Vimpelles ce qui s’est passé en 1818, au
moment de la démolition de l’ancien château-ferme d’Heurtebise, qui avait
appartenu aux religieux de Saint-sauveur-les Bray, dépossédés à la Révolution.
La célèbre Mme Campan, surintendante de la maison de la Légion d’honneur
d’Ecouen, venait de vendre en détail ce domaine d’Heurtebise qu’elle avait
acquis en 1800 ; les ouvriers occupés à la démolition des bâtiments
s’imaginèrent que les souterrains recélaient de grosses sommes d’argent dans
les cachettes pratiquées jadis par les moines. C’était une tradition. Ils
n’hésitèrent pas à suivre les errements qui avaient si mal réussi 65 ans
auparavant à leurs voisins de Lizines. On eut recours, moyennant finance, à de
prétendus sorciers qui se livrèrent à des exercices cabalistiques le dimanche
des Rameaux, et opérèrent pendant la lecture de l’Evangile. Ce spectacle
ridicule, annoncé d’avance, attira la foule à l’entrée des souterrains et
aboutit fatalement à la confusion des chercheurs de trésor. Si la justice n’intervint
pas, cette fois, peu s’en fallut que les curieux mystifiés ne fissent eux-mêmes
un mauvais parti aux sorciers en défaut »(5).
Les trois soleils de Thénisy, ou la
chasse au trésor programmée
À la date du 20 Août 1952, on peut lire dans le cahier de Pierre
V : « Thénisy, tous les
ans, le matin du jour de la Sainte Trinité(6) au sommet d’une
petite colline au nord du village, s’ouvre dans le sol, l’entrée d’une cave qui
contient un trésor. On prétend qu’à ce moment-là, on peut voir apparaître trois
soleils dans le ciel ».
Presque cent ans auparavant, on trouve déjà cette légende,
cette fois-ci sans le trésor et la cave, chez François-Antoine Delettre :
« En se plaçant sur un point élevé
du territoire de Thénisy, le jour de la fête de la Trinité, au soleil levant,
on en découvre trois à l'œil nu »(7). Dans
ses : Notes complémentaires sur
Saint-Lié de Savins, Cosette Khndzorian-Iablokoff suggère que cette
tradition est peut-être le vestige d’un culte solaire(8).
 |
EMPLACEMENT DE LA CAVE GILETTE (CADASTRE NAPOLEONIEN DE LA COMMUNE DE THENISY, DOCUMENT ADSM) |
Après recherche sur les différents plans à disposition, j’ai pu trouver sur le cadastre napoléonien un lieu-dit, absent aujourd’hui des plans actuels, pouvant correspondre aux descriptions de nos deux auteurs. Il s’agit de : Le Fond de la Cave Gilette. Il se situait au nord-nord-ouest du bourg à environ 110m d’altitude, soit un peu plus de 20 m de plus que celle du village. Vu sous cet angle, l’endroit présente une légère hauteur que je n’irai pas jusqu’à qualifier de colline, mais qui pourrait néanmoins faire l’affaire. Le second aspect positif, c’est que ce climat est le seul à porter un nom de cave. En l’absence d’informations complémentaire, la probabilité pour que la Cave Gilette soit celle de la légende me paraît donc assez élevée. Prudence quand même, on a vite fait de penser, à notre humble niveau, qu’on est dans le vrai alors qu’il y aurait des tas d’arguments pour nous prouver le contraire.
Concernant la remarque de Cosette sur le vestige d’un culte
solaire, je pencherai plutôt pour une symbolique naturelle de la Trinité :
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui seraient tout simplement représentés
par les 3 soleils.
(1) Coordonnées : X : 0660.292 /
Y : 1084.009. Ce climat présent sur le cadastre napoléonien a été remplacé
depuis par : Les Petits Champs Beaux sur les plans récents. Il est
mentionné : Les Cuves, sur la carte IGN 2516E, Donnemarie-Dontilly.
Sur le plan d’intendance de 1781, le lieu-dit La Cave se trouvait sur
l’actuel : La Pente d’Heurtebize, situé au-dessus du village de
Vimpelles.
(2) Cahier Pierre V, date du 17/08/1952.
(3) Il était situé dans
l’angle sud-est du carrefour de la Départementale 18 et de la Voie communale du
Chemin départemental 18, parcelle 31, lieu-dit actuel La Pente d’Heurtebize.
Coordonnées approximatives : X : 0660.778 /Y : 1082.770.
(4) Maurice Pignard-Péguet : Histoire
générale illustrée des départements : Seine-et-Marne, Orléans, 1911, p
781.
(6) Pour rappel, la Sainte
Trinité est célébrée le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est-à-dire le
huitième dimanche après Pâques.
(8) Cosette Khndzorian-Iablokoff : Notes complémentaires sur Saint-Lié de
Savins, Bulletin de la SMF n°89, 1973, p 49.
Doublon
À un peu plus de 2 km au nord du
village d’Égligny, subsistent les vestiges de l’abbaye cistercienne de Preuilly(1). Sa
fondation date de 1118. Démantelée à partir de 1791, on doit la conservation du
site au Docteur Henri-Marie Husson et à son épouse Zoé Odiot qui en devinrent
propriétaires au cours du XIXème siècle, et mirent fin aux travaux
de destruction. A l’heure actuelle, les ruines du monastère se réduisent aux
murs latéraux de la nef et à ceux du chœur de l’église, le croisillon sud du
transept, les soubassements de la salle capitulaire et les parties anciennes des
fermes des Beauvais et du Domaine.
 |
RUINES DE L'ABBAYE DE PREUILLY (EGLIGNY) |
La légende rapporte qu’il y avait
un trésor caché dans les caves de l’abbaye. Sa situation n’est pas localisée
avec exactitude, mais Lecotté précise que cette cave : « S’ouvre le Dimanche des Rameaux pendant
qu’on lit l’Evangile de la Passion à Dontilly »(2).
Pierre V qui avait déjà prospecté
sur la commune voisine de Vimpelles, note, à la date du 17/08/1952 :
« Il existerait des caves sous les
ruines de l’ancienne abbaye de Preuilly, ainsi que plusieurs souterrains. L’un
d’eux irait jusqu’à Provins(3). Un autre déboucherait
dans le Bois de Preuilly tout proche. Son entrée ne s’ouvrirait que pendant le
jour des Rameaux, quand le prêtre lit l’évangile de la Passion dans l’église de
Dontilly. Ce souterrain conduirait à une cave de l’abbaye qui renfermerait le
trésor des moines. Ce trésor est soi-disant gardé par un diable. A la
révolution, des ouvriers chargés de démolir le monastère firent des fouilles
clandestines dans les caves de plusieurs bâtiments, espérant trouver le trésor
de Preuilly. Il n’y avait rien »(4).
Comme on peut le constater, il
existe beaucoup de similitudes entre cette tradition de trésor merveilleux et
celle du village voisin de Vimpelles. Une fois encore, il est possible qu’il y
ait eu contamination ou réappropriation du mythe par les habitants de l’une des
deux communes. Ne perdons pas de vue que le site du fief d’Heurtebise et celui
de l’abbaye de Preuilly ne sont séparés que d’à peine 4 km.
(1) Coordonnées : X : 0657.473 / Y : 1083.136.
(2) Roger Lecotté : Les cultes populaires dans
l‘actuel diocèse de Meaux, Mémoires de la fédération folklorique
d'Île-de-France, Paris, 1953, p 110.
(3) A vu de nez, ce souterrain atteindrait
une longueur appréciable de 18 km (c’est moi qui précise).
(4) Cahier Pierre V, date du
17/08/1952.
Canton de la Ferté Sous Jouarre
Le Trésor de
Minuit
Informé dès 1939 par le folkloriste Pierre-Louis Menon, Roger
Lecotté rapporte que l’église du village de Pierre-Levée aurait été bâtie sur l’emplacement d’un menhir(1)
aujourd’hui détruit. Autant mettre les choses au point tout de suite : à
l’heure actuelle et en l’absence de données archéologiques fiables, personne n’est
en mesure d’étayer cette hypothèse, si séduisante soit-elle. Nous ne sommes
donc qu’en présence d’une simple tradition locale, même si le toponyme est
suffisamment parlant pour que cette éventualité soit à prendre au sérieux. On
sait que la majorité des noms de lieu de ce type ont souvent été donnés à des
dolmens et des menhirs, disparus ou non. Mais des fois pas. Il s’agit donc de
prendre quelques précautions avant de s’emballer.
Passons à la légende, bien réelle cette fois-ci, sur le
papier, j’entends. N’en déplaise à René-Charles Plancke(2), ce
n’est pas grâce à Paul Bailly que celle-ci a été conservée. Exhumée, sans
doute, mais sa préservation, elle, est due à un certain François Brazillier.
Rendons à césar …,
vous connaissez la formule. A ce propos, pour cet auteur, le monument qui a
donné son nom au village est la dalle d’ouverture du caveau qui renferme le
trésor, une pierre magique par excellence, et non pas un bloc érigé par les
hommes du néolithique. Paul Bailly, lui, n’en démords pas : c’est bien le
menhir « qui cachait un trésor qui
se découvrait pendant les douze coups de minuit de Noël ».
Arrêtons de chipoter pour si peu et voyons de quoi il
retourne :
« Il y a bien
longtemps de cela ! Si longtemps que le souvenir s’en est perdu à travers
les générations. Entre Crécy-en-Brie et Jouarre-l’Abbaye, s’étendait alors une
immense futaie, dont la forêt du mans, les bois de Jouarre et quelques bouquets
d’arbres intermédiaires, ne sont que les vestiges. Au centre de l’une des
clairières qui trouaient çà et là ces sombres solitudes, quelques huttes de
serfs se cachaient dans un pli de terrain. Tout près de ce misérable hameau,
une tour démantelée dressait, parmi les premiers arbres, son sinistre
silhouette. Une terreur superstitieuse planait autour de cette ruine maudite,
dont le noir caveau recélait, disait la rumeur populaire, un trésor
fantastique, qu’y avaient accumulé les rapines et les brigandages d’un seigneur
Franc, foudroyé par la justice divine au moment où il tentait l’assaut de
l’Abbaye. La fureur des opprimés avait rasé le château de l’oppresseur, ne
laissant debout que le donjon mutilé sous lequel gisait le trésor sacrilège. Ce
trésor, nul ne l’avait vu, car nul n’eut osé pénétrer dans la tour maudite. Mais
tous les ans, à Noël, pendant que sonnait au lointain beffroi de l’Abbaye les
douze coups de minuit, la ruine s’illuminait d’une lueur sanglante. C’était,
disait-on, la pierre du caveau qui se levait, mettant à nu le monstrueux amas
de richesses, dont les sinistres reflets allumaient l’étrange incendie.
Or, en cette nuit de
Noël, le vent du nord faisait rage à travers les ogives éventrées et les
créneaux démantelés. Derrières la sombre silhouette, la haute futaie se tordait
hurlante sous la rafale impitoyable. De l’âme de granit des pierres disjointes,
une plainte lugubre, incessante, s’échappait, emplissant l’ombre de bruits
mystérieux, qui s’en allaient, sur l’aile glaciale de la bise, porter au loin
l’épouvante et l’horreur. Arrêtée à l’orée du bois, une femme jeune encore et
misérablement vêtue, couvrait d’un regard d’ardente convoitise la masse noire
du donjon qui se profilait à quelques pas d’elle dans la nuit. Roulé dans son
tablier, un enfant dormait sur son sein.
- Dors, mon jacques,
murmurait-elle en une plainte dolente. Dors ! Tu seras riche. Pour toi, je
braverai les mystères de la tour maudite. Ce trésor, je l’aurai ! Car je
ne veux pas que tu aies faim. Quand ton père vivait, je pouvais encore te
donner un peu de pain noir. Mais maintenant, c’est la misère, c’est la mort !
Et je ne veux pas que tu meures, mon Jacques adoré. Si je fais mal, Dieu me
pardonnera à cause du grand amour que j’ai pour toi… soudain le vent apporta à
ses oreilles le dernier coup de la messe de minuit :
Di din don…
Gloire à Dieu !
Di din don…
Dans les Cieux !
Chantait le joyeux
carillon…
Baoum ! Baoum !
Noël ! Noël !
Scandait la voix grave
du bourdon…
Di din don…
Di din don…
Mon trésor
Est plein d’or !
Baoum ! Baoum !
Viens ! Viens !
Répondait l’écho du
donjon maudit.
Un combat se livrait
dans le cœur de la malheureuse mère. Allait-elle, pour la première fois de sa
vie, manquer la messe de minuit ? Que faisait-elle là ? Pourquoi
n’était-elle pas déjà là-bas à sa place au fond de l’église ruisselante de
lumière ? Dieu n’allait-il pas la punir ?
Elle abaissa, sur son
doux fardeau, un regard angoissé.
- Mère ! sourit
l’enfant dans son sommeil. Ah ! le voir ainsi sourire toujours ! Le
voir toujours heureux !...
Les cloches se turent…
Elle se précipita dans la tour et tomba à genoux devant la pierre du caveau.
- Mon Dieu !
Pardon ! gémit-elle dans un sanglot.
- C’est pour mon
enfant !
Autour du donjon, la
tempête redoublait :
Hou ! Hou ! Hou !
La messe est commencée !
Mugissait le vent par
l’étroit soupirail…
Hou ! Hou ! Hou !
Les anges ont chanté !
Bramaient les oiseaux
de nuit voletant parmi les créneaux démantelés…
Hou ! Hou ! Hou !
L’Enfant Jésus est né !
Hurlaient les loups au
fond des bois…
Soudain, le premier
coup de minuit tinta dans le lointain. Avec un bruit de tonnerre, l’abîme
s’ouvrit, étalant, aux yeux éblouis de la pauvre mère ses incalculables
trésors. Affolée, elle bondit au milieu de cet amas de richesses, posa près
d’elle l’enfant endormi, et se mit à emplir avidement son tablier.
Baoum ! Baoum !
Continuait
l’implacable beffroi…
Encore ! Encore !
Répétait la
malheureuse insatiable et grisée !
- Mère ! … appela
l’enfant qui s’éveillait.
- Mon fils ! …
s’écria la mère sortant tout à coup de
son terrible enivrement… D’un bon, elle est hors du gouffre,… vide brusquement
son tablier et se retourne…
- Baoum ! …
pleura le dernier coup de minuit.
- Boum ! fit la
dalle se refermant sur l’innocent.
- Mon enfant ! …
perdu ! … râla la pauvre mère.
- Perdu, ricane l’écho
du donjon, tandis que l’infortunée roulait évanouie sur la pierre implacable.
Quand elle revint à elle, la pauvre mère était folle. Les mains crispées autour
de son tablier, où machinalement elle avait entassé l’or et les diamants
emportés du caveau maudit, elle s’en allait, falote en ses haillons, dodelinant
de la tête, répétant sans cesse par le hameau et les villages voisins sa
dolente complainte :
- Dors mon Jacques
adoré ! Dors ! Tu seras riche ! Pour toi, je braverai la tour
maudite ! Dors, dors ! Tu seras riche !
Et, souriante, elle
berçait sur son sein, en une navrante tendresse, la terrible rançon de son
enfant.
 |
| ALMANACH DE SEINE-ET-MARNE, 1898 (PIERRE-LEVÉE) |
*
L’hiver était revenu,
ramenant la nuit de Noël. Dans la clairière, sur les grands bois, pas un
souffle ! Au ciel scintillait l’innombrable armée des étoiles, clous d’or
piqués sur le velours bleu de l’espace. Appuyée contre un vieux chêne, la folle
écoutait l’harmonie lointaine des cloches sonnant la messe. Devant elle,
l’ouverture du sinistre caveau baillait, trou noir dans la nuit. Lentement, pas
à pas, la malheureuse mère, poussée par une force mystérieuse, s’avança vers la
ruine maudite. Le premier coup de minuit la trouva agenouillée devant la pierre
fatale. Sans bruit, l’abîme s’entrouvrit. Dans un ruissellement d’or et de
gemmes merveilleuses, son enfant souriait, l’appelant et lui tendant les bras.
- Mon enfant !
Mon trésor et ma vie ! s’écria-t-elle, recouvrant soudain la raison, et se
précipitant comme une lionne.
De son tablier
déroulé, diamants et pièces d’or, rubis et topazes, saphirs et perles fines,
roulaient pêle-mêle, rebondissant sur la pierre, étincelant comme une poussière
d’étoiles. Mais que lui importaient désormais ces richesses maudites !
D’un geste emporté, elle enleva son fils dans ses bras… C’était trop de
bonheur ! Ses genoux fléchirent, et elle tomba sans forces sur
l’avant-dernière. Horreur ! Le dernier coup de minuit sonnait ! D’un
effort surhumain, ses bras se détendirent, jetant l’enfant hors du
gouffre !...
O merveille !
L’abîme ne se referma pas. Tour maudite, infernal trésor avaient disparu. Seule
la pierre fatale était restée debout.
L’enfant souriait à sa
mère, lui montrant tout joyeux une petite croix de gemmes incomparables que ses
mains avaient innocemment ravie au trésor de minuit. Le prodige fit grand
bruit. Sur l’emplacement du château, la piété reconnaissante de la mère éleva
une chapelle. A l’ombre du modeste édifice, des maisons s’élevèrent,
transformant peu à peu le hameau en un coquet village qui prit le nom de
Pierre-Levée, qu’il porte encore aujourd’hui »(3).
(1)Roger
Lecotté :
Les cultes populaires dans l‘actuel diocèse de Meaux, Mémoires de la
fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 40.
(2)
René-Charles Plancke : La « compile » des mégalithes ou menhirs et
dolmens en Seine-et-Marne, Notre Département : la Seine-et-Marne, N°47,
Février-Mars 1996, p 46.
(3)
François Brazillier : Le Trésor de Minuit, conte de Noël, Almanach de
Seine-et-Marne, 1898, p 163 à 170.
Canton de Tournan-en-Brie
Encore une
histoire de chercheur de trésors qui finit mal
On a souvent placé le manoir de Cresnes sur la commune de
Guignes, alors que finalement, il n’en est rien. Roger Lecotté(1), René-Charles
Plancke(2), et
même René Morel qui a habité Guignes, mais reste imprécis sur sa localisation, ne
seront sûrement pas les derniers à le faire. Pourtant, il existe plusieurs
plans(3), dont
le cadastre Napoléonien, qui indiquent clairement l’emplacement des ruines de
ce château. En superposant le plan du cadastre à la carte IGN actuelle, on parvient
même à les situer précisément. Ce qu’il en reste, se trouve aujourd’hui dans la
pointe sud-ouest de la commune de Chaumes-en-Brie,
à l’intérieur et à l’extrémité sud d’une propriété boisée bordant la D 402, au
point : X : 0635.096 / Y :
1105.013. Une maison s’élève à proximité. Mr Bernard Champion, qui a travaillé
à la construction de ce bâtiment il y a 40 ans, se souvient avoir vu quelques
restes de fondations. Mieux, il s’est rendu sur place au mois de Février 2013
et voici ce qu’il m’a fait parvenir :
« Le propriétaire,
Mr Patrick Pionnie, m’a gentiment permit de visiter le lieu et prendre quelques
photos. La maison semble avoir été construite en bordure du fossé, près de
l'angle nord, à l'extérieur des ruines. Elle est sur une butte d'environ 2 m
par rapport au reste du terrain. Si, coté nord-est, le remblai autour de la
maison et le chemin créé pour accéder à celle-ci a effacé les traces d'une
quelconque construction, il reste un fossé coté sud-ouest avec un retour sur le
coté nord-ouest alimentant une petite mare que le propriétaire a creusé. Côté
sud-est, partant de l'entrée de la propriété jusqu'à l'angle sud, une petite
butte tout en longueur signale les restes d'une construction »(4).
Pour résumer, ne subsiste actuellement sur le site, que des
vestiges de fossés au sud-ouest, et au
nord-ouest, ainsi qu’une petite butte de nature indéterminée. A l’heure
actuelle, tout ce qui a pu ressembler, de près ou de loin, à un château a
complètement disparu. On peut supposer, avec d’infimes précautions, et à l’aide
des plans à disposition, que la destruction de cet édifice remonte bien avant
le 17ème siècle. Mais rien n’est moins sûr, d’autant que je n’ai
trouvé aucun document relatif à son sujet. L’histoire rappelle toutefois qu’au
moyen âge, le vieux fief de Cresnes appartenait à Jude de Cresnes, dame
d’Ozouer-le-Voulgis qui en 1206, avait fait don de 500 arpents de bois au
village pour remercier ses habitants de l'avoir aidée à payer la rançon de son
mari, prisonnier à Jérusalem lors d'une croisade(5). Pour
le reste, faisons une fois de plus confiance à René Morel et à sa légende de la
Cave au Diable et de son trésor souterrain(6). Nous
sommes là pour ça, après tout. Une dernière chose : dans la réédition du
livre, Au Village de France(7), de Pierre-Louis
Menon et Roger Lecotté, on a placé la légende du Manoir de Cresnes dans
l’actuelle ferme de Vitry. Bien entendu, tout cela n’a pas lieu d’être.
 |
| LÉGENDE DU MANOIR DE CRESNES DESSIN DE RENE MOREL ALMANACH DE SEINE-ET-MARNE 1891 (CHAUMES-EN-BRIE) |
« Une croyance
populaire fort accréditée au bon vieux temps parmi les habitants de
Guignes-en-Brie et des environs, prévenait que les ruines de la masure de
Cresnes recouvraient un souterrain renfermant d’immenses trésors et que chaque
année, le dimanche des Rameaux, pendant la lecture de la Passion, au moment où
le prêtre prononçait ces paroles : Jesus autem, iterum clamans voce magna
emisit spiritum, un large trou s’ouvrait et laissait apercevoir l’entrée de ce
souterrain. Malheur à l’imprudent qui, poussé par la cupidité, descendait dans
ce trou ! A peine avait-il fait quelques pas que l’ouverture qui lui avait
livré passage se refermait d’elle-même et le séparait à jamais des vivants…
aussi, malgré la fascination que ces richesses fabuleuses exerçaient sur les
habitants de la contrée, se gardait-on bien de descendre dans ce souterrain qui
devait servir de tombeau.
On racontait cependant
qu’un jeune homme de la seigneurie de Vitry, plus hardi ou moins superstitieux
que les autres, avait eu le courage de s’aventurer dans la Cave au Diable,
comme disaient en se signant, nos pieuses et crédules aïeules. Hélas ! Le pauvre
gars, jamais il n’était revenu de ce terrible voyage, et ses os blanchissent
peut-être encore au fond du souterrain…
L’amour était seul
capable d’inspirer un pareil courage, de faire commettre une telle folie.
Jehan était amoureux
fou d’une gente filandière, la blonde Aliette, et la belle enfant adorait
Jehan, mais un obstacle insurmontable s’opposait à leur bonheur : Jehan
était aussi pauvre qu’amoureux. Le grand-père d’Aliette, maître Guillaume,
prévôt de Vitry, rêvait de faire faire à sa petite-fille un riche mariage, et
il avait jeté son dévolu sur un vieillard de Melun, un homme fortuné s’entend,
car maitre Guillaume n’était pas né de la dernière pluie.
Anastase, l’époux
choisi par le grand-père, était laid et méchant, puant comme un bouc, jaloux
comme un tigre et avare comme pas un, mais il avait des champs, des prés, des
bois, des vignes et des maisons volés de côté et d’autre ; il avait des
pièces d’or et d’argent escroquées un peu partout, il avait enfin, pensait le
bienheureux Guillaume, tout ce qu’il fallait pour rendre une femme parfaitement
heureuse.
Tel n’était pas l’avis
d’Aliette, de la belle Aliette aux cheveux d’or, aux grands yeux bleus, à la
figure si gracieuse, au cœur si tendre, aux grâces et aux vertus si parfaites.
Jehan, le beau Jehan, le roi des bûcherons d’alentour, lui convenait bien mieux
avec son corps d’athlète souple et nerveux, élégant et robuste, avec son beau
visage avenant éclairé par des yeux pleins de flammes et de caresse, égayé par
un doux sourire…
Il était aussi bon que
beau. Nul ne le devançait pour accomplir un devoir, pour faire une bonne
action… Aliette pensa mourir de douleur en apprenant le choix fait par son
grand-père. Elle se jeta tout en larmes à ses pieds, elle lui avoua l’amour
immense qu’elle éprouvait pour Jehan et elle le supplia de renoncer à une union
qui ne lui inspirait qu’horreur et dégout… Maître Guillaume, croyant agir dans
l’intérêt de sa petite-fille, resta sourd à toutes les prières et insensible à
toutes les larmes. Peu lui importait, l’amour des deux jeunes gens ! Il ne
voyait que l’argent, le pauvre homme, et pour lui tous les Jehan du monde ne
valaient pas les écus du vieillard.
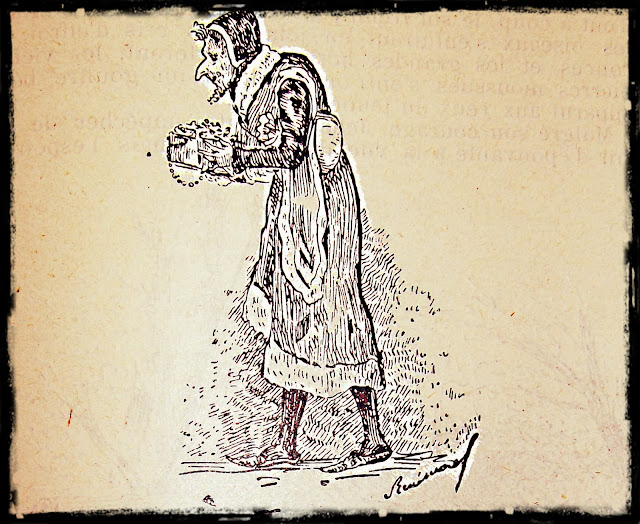 |
| LÉGENDE DU MANOIR DE CRESNES DESSIN DE RENE MOREL ALMANACH DE SEINE-ET-MARNE 1891 (CHAUMES-EN-BRIE) |
Le jour fixé pour le
mariage d’Aliette et d’Anastase approchait rapidement. Déjà ce dernier avait
offert à sa fiancée, des joyaux dignes d’une reine, déjà il avait acheté pour
elle les étoffes les plus précieuses et les plus riches parures. Sa passion
sénile l’emportant sur l’avarice lui faisait prodiguer l’or, et il allait
jusqu’à vouloir mettre dans la corbeille de mariage, un tortil de baronne pour
couronner les blonds cheveux d’Aliette. La pauvre enfant devenait folle de
désespoir. Elle attendait le moment de cette union maudite comme le condamné à
mort attend l’heure du supplice. La douleur du malheureux Jehan n’était pas
moins cruelle, mais la force d’âme du vaillant jeune homme l’empêchait de se
livrer au désespoir sous lequel succombait la faible et craintive jouvencelle.
Il était déterminé à tout faire pour arracher Aliette, son Aliette adorée, la
pensée de ses jours et le rêve de ses nuits, à l’odieux vieillard qui la
convoitait, et puisqu’il fallait de l’or pour la posséder, il en aurait !
Dût-il donner son âme au Diable ! Le souvenir du trésor de Cresnes
s’offrit alors à son esprit… Il se voyait déjà possesseur de ces immenses richesses.
Que de bonheur lui promettait cet or ! Il serait plus riche que tous les
barons de Champagne et de Brie, il serait plus heureux que tous les rois de la
terre…
Quelques jours
seulement le séparaient de l’instant où il était permis de pénétrer dans le
souterrain. Sa résolution fut bientôt prise et devint inébranlable ; la
mort, du reste, lui semblait préférable, à la perte d’Aliette. Le dimanche de
Pâques fleuries, Jehan se dirigea donc vers les ruines de Cresnes et là
attendit que le trou s’ouvrit…
Tout à coup, le sol
frémit, un frisson agita le feuillage, les oiseaux s’enfuirent en jetant des
cris d’effroi, les ronces et les grandes herbes s’écartèrent, les vieilles
pierres moussues s’entrouvrirent et un gouffre béant apparut aux yeux du jeune
homme. Malgré son courage, Jehan ne put s’empêcher de frémir d’épouvante à la
vue du prodige, mais l’espoir de sortir du souterrain avec les richesses qui
devaient lui donner du bonheur, ranima son énergie si robuste, et faisait appel
à tout son amour, à tout son courage, il posa le pied sur la première marche
d’un escalier qui descendait dans l’abime et disparut en prononçant le nom
chéri d’Aliette ! … Au même moment, un ricanement diabolique sembla sortir
du souterrain, un bruit étrange se fit entendre dans les ruines, des
gémissements s’élevèrent des profondeurs de la terre, les pierres craquèrent,
les herbes se courbèrent sous un souffle mystérieux… Puis, tout retomba dans le
silence et la Cave au Diable, se referma, ensevelissant sa victime…
*
Guidée par son amour,
Aliette se rendit aux ruines de Cresnes, et on rapporte qu’elle entendit la
voix de son bien-aimé, s’élever, gémissante du fond du souterrain.
Le lendemain de la
disparition de Jehan, un pâtre trouva au milieu des ruines sinistres, à
l’endroit où se creusait une fois par an le trou qui avait livré passage à
l’infortuné jeune homme, le cadavre de la belle Aliette aux cheveux d’or, aux
grands yeux bleus, aux grâces et aux vertus si parfaites… La douleur avait tué
la pauvre enfant.
Les ombres des deux amants
hantèrent pendant des siècles les ruines du vieux castel et la légende assure
que les jeunes filles qui les apercevaient n’épousaient pas celui qui possédait
leur cœur »(8).
 |
| LÉGENDE DU MANOIR DE CRESNES DESSIN DE RENE MOREL ALMANACH DE SEINE-ET-MARNE 1891 (CHAUMES-EN-BRIE) |
(1) Roger
Lecotté :
Les cultes populaires dans l‘actuel diocèse de Meaux, Mémoires de la
fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 188.
(2) René-Charles
Plancke :
Mormant et ses environs à la Belle Epoque, Amattéis, 1994, p 278.
(3) Informations
de Mr Bernard Champion : Terrier de la seigneurie de Maurevert de 1733
(ADSM. réf : E 1033), Carte de la seigneurie de Maurevert de 1778 (Extrait du
terrier de Chaumes, ADSM, réf : H72), Plan de la commune de chaumes daté de
1890.
(4) Bernard
Champion,
mail du 04/02/2013.
(5) Hommage
à Jude de Cresnes,
inscription 1865, Église Saint-Martin, Place de l'église, Ozouer-le-Voulgis.
(6) Certains passages jugés
politiquement incorrects ont été modifiés. Pour la VO, consulter l’article
original.
(7) Pierre-Louis
Menon et Roger Lecotté : Au village de France : la vie traditionnelle des
paysans, iconographie nouvelle réunie et commentée par René-Charles Plancke
/ Lys éd. presse-Éd. Amattéis, 1993, p 53.
(8) René
Morel :
Histoires et légendes d’un petit coin de la Brie : la Cave au Diable,
Almanach de Seine-et-Marne, 1891, p142 à 147.
Canton de la Ferté Gaucher
Miscellanées
et structures diverses pour trésor unique
On a toujours prétendu qu’il existait autrefois, sur la
commune de Chartronges, un château
féodal qui aurait été abandonné, puis détruit à une époque inconnue. Aucune
trace écrite, aucun document ne semble pourtant confirmer cette allégation,
pourtant bien ancrée dans la mémoire du village. Du point de vue de
l’archéologie, les choses sont quelques peu différentes. Charles-François
Férand, cité par Pierre Geslin, pensait avoir découvert, à proximité de l’emplacement
supposé du château, un camp retranché gallo-romain. D’après lui, il y aurait :
« Sur le territoire de Chartronges
des vestiges d'un ancien retranchement. Ces vestiges sont au lieudit le
Grandchamp ou le Grandcamp, situé sur un point culminant qui commande la plaine
environnante. On reconnaît que le terrain y a été nivelé de main d’homme.
Aujourd'hui, bien que la culture y ait depuis longtemps fait passer la charrue,
on voit encore l’équerre formée par deux tronçons de fossés, dont l’angle est
arrondi. Ces tronçons ont, l'un 50 m, l'autre 112 m de longueur, la largeur en
est de 5m et la profondeur de plus de 2 m, mais ces dimensions devaient être
plus considérables avant le comblement partiel qu’ils ont subi. L’aspect des
lieux donne à penser que le camp, de forme rectangulaire, ne devait pas avoir
moins de 200 m dans un sens et 300 dans l'autre. L'emplacement et les
environs présentent des débris de construction, tels que pierres enveloppées de
ciment rouge, et tuiles à rebord.»(1).
Ce site serait
localisé sur le bord ouest du chemin antique de Jouy à Béton-Bazoches, à
l’endroit où il est coupé par la D111(2),
c'est-à-dire approximativement au point : X 0667.111 / Y : 1117.146, lieu-dit actuel, Les Bordeaux. La fiche du SRA(3),
elle, le situe au niveau d’un « coude » (symbole d’un fossé) visible
sur la cadastre napoléonien de 1839, c'est-à-dire environ 350m plus au nord, au
point approximatif : X : 667,225 / Y : 1117,475.
Pierre Geslin qui a prospecté les lieux en 1992 a mis au
jour des tegulae(4), de
la céramique gallo-romaine et des tessons d’amphore gauloise(5),
ainsi que des tuiles et de la céramique vernissée médiévale(6).
Aujourd’hui, ces vestiges sont pratiquement indécelables, voir quasiment invisibles.
« Une photographie aérienne à axe
vertical, prise en 1964 par l'Armée de l'Air, montrait à 1 500 mètres au
nord-ouest de Chartronges un détail évoquant l'angle des fossés décrit par M.
Férand. Les clichés plus récents n'en portent plus la trace. Sur le terrain, on
distingue encore une grande ondulation en relief qui dessine un angle ouvert
vers le sud-ouest. Le cadastre, consulté après la reconnaissance de terrain,
confirme qu'il s'agit bien de l'endroit désigné par M. Férand : le Grand
Champ »(7).
En outre, il suppose que : « Le site a été réoccupé à l'époque médiévale si l'on en juge par
l'abondance de la tuile de cette époque-là. Une légende fait encore état d'un
vieux château qui aurait existé à cet endroit. Le maire de Chartronges affirme
être lui-même descendu, en bordure du chemin qui passe juste à côté du champ,
dans un dans un souterrain orienté du sud au nord, et long de plusieurs mètres »(8). « En face de l’entrée se situerait un bâtiment
à deux tours visible sur le cliché IGN de 1964»(9). Ce
souterrain est peut-être celui inventorié par le Bureau de Recherches Géologiques
et Minières en 2004(10),
situé au point : X : 0667.158 / Y : 1117.268.
 |
| STRUCTURE REPÉRÉE PAR PAUL BRUNET en 1996, PHOTO PAUL BRUNET (CHARTRONGES) |
Pour terminer, l’archéologue Paul Brunet, prospecteur aérien
archéologique et secrétaire de la Société d'histoire et d'archéologie de Lagny
et environs, « A reconnu à cet
endroit plusieurs structures en 1996 : une enceinte subcirculaire aux
larges fossés, correspondant à la structure de Charles-François Férand (le
fossé semble en effet plus large et marqué sur les côtés nord et est) et
interprétée comme une motte féodale ; de l’autre côté du chemin, on
observe également une structure rectangulaire avec un l’intérieur un rond et
une grande structure quadrangulaire avec un chemin y menant »(11). Il
précise : « Le seul problème
est d'interpréter ce genre de structures. Geslin y a trouvé un peu de tout, ce
qui ne permet pas vraiment d'y trouver un indice chronologique d'autant qu'il
existe deux structures séparées et qui n'ont peut-être aucun lien
entre-elles »(12).
Les
coordonnées de ce nouveau site sont : X : 667,225 / Y : 1117,475,
lieu-dit actuel : Grand Champ.
Il correspond à l’emplacement du « coude » visible sur le cadastre
napoléonien de 1839.
Si à l’heure d’aujourd’hui,
il est difficile de certifier que l’un des sites précédents abritait bel et
bien un château féodal, les difficultés ne s’arrêtent pas là. La tradition
n’échappe pas non plus à la norme. Une
fois de plus, existe sur la commune une légende de trésor merveilleux, et comme
on le verra suivant les témoignages recueillis, l’emplacement et la structure supposée
renfermer ces richesses ne sont jamais les mêmes.
Commençons
par le plus ancien. Il s’agit de celui de l’instituteur Joseph Massoul
mentionné dans la monographie du village de Chartronges en 1881 :
« Un château féodal a du exister sur le
territoire de la paroisse de Chartronges, au lieu-dit des Grandchamp. On trouve
en effet encore aujourd’hui des traces très visibles des fossés qui ont entouré
ce domaine seigneurial et des ruines enfouies sous la couche arable et que la
charrue à mises plusieurs fois à découvert, indiquent qu’une construction assez
importante a existé autrefois dans cet endroit (...) Si l’on en croit la
légende, les seigneurs de Grand Champ n’étaient pas de mœurs très
hospitalières, puisqu’on raconte qu’ils coupaient la tête de tous les habitants
de Choisy qu’ils appelaient les Coulas de Choisy et des habitants de
Jouy-sur-Morin, les Ventres Jaunes, qui passaient à proximité du château. Il
n’y avait d’épargnés que les Passe-Tout-Doux de Chartronges, probablement parce
qu’ils étaient de la localité. Les âmes de ces malheureuses victimes de la
cruauté des seigneurs, d’après ce qu’on racontait autrefois dans les veillées,
passaient dans le corps de divers animaux, qui, dans la suite des siècles, on
continué à errer aux environs du Bois de Grand Champ. Il se trouve encore de
bonnes vieilles femmes à Chartronges, qui racontaient, sans rire, qu’elles ont
vu la bête de Grand Champ. Cette bête était tantôt un renard qu’un charretier,
une forte tête de ce temps-là cependant, mort il y a quelques années seulement,
a vu se reposer sur la haie de sa charrue. Après avoir chassé cette bête dont
la hardiesse le surprenait un peu, il fut tout étonné de la voir revenir
aussitôt au même endroit ; il pensa alors à la bête de Grand Champ et,
saisi de frayeur, il se hâta de dételer ses chevaux et il s’en retourna
précipitamment chez lui. Une autre fois, c’est un coq qu’un habitant de
Féraubry trouve aux environs de Grand Champ ; il le prend, le met dans un
panier, l’emporte chez lui et l’enferme dans son poulailler. Le lendemain, le coq
avait disparu sans qu’on puisse savoir par où il était passé, etc. etc.
On racontait aussi autrefois dans les
veillées qu’un trésor était déposé dans une cave au château de Grand Champ,
dont l’entrée se trouvait dans le Bois de la Collinaude, situé à proximité du
château. La porte de cette cave, et d’après la légende, n’est ouverte qu’une
fois l’année, pendant la lecture de la passion, à la messe des Rameaux. Ceux
qui veulent visiter cette cave et puiser à pleines mains dans les monceaux d’or
qu’elle renferme, doivent se hâter, car aussitôt la lecture de l’évangile
terminée, la porte se referme et on ne peut plus en sortir. Une bonne femme,
qui voulut une année tenter l’aventure, s’était attardée à ramasser les sous
dont les marches de la cave sont garnies, fut surprise par la fin de l’évangile
et n’eut que le temps de retourner sur ses pas et de sortir, car soudain la
porte se refermait sur elle et retenait une partie de ses vêtements, dont elle
dut faire le sacrifice pour se tirer d’embarras. Il faut supposer qu’elle avait
trouvé assez d’argent pour réparer le désordre de ses vêtements assez
sérieusement endommagés.
On suppose que le château de Grand Champ a
été détruit par un incendie, car on a trouvé dans les ruines du blé brûlé et
parfaitement conservé »(13).
Ce témoignage est celui qui me
semble le plus proche d’une certaine réalité géographique et archéologique. En
effet, Massoul place la cave au lieu-dit Le
Bois de la Collinaude, climat qui, sur le cadastre napoléonien, se situe le
long du bord est du chemin antique de Jouy à Béton-Bazoches, c'est-à-dire à
quelques pas du camp retranché étudié par Férand.
 |
| LE RENARD NOIR, LA BÊTE DE GRANDCHAMP (CHARTRONGES) |
Celui d’Henri Menu, quoique plus
riche dans les détails et mieux écrit, est nettement moins précis dans la
localisation du trésor qu’il situe dans le Bois
de Grand Champ. Ce bois n’existe plus aujourd’hui. Il s’étendait à 200m au
nord-ouest du site décrit par Férand, au point X : 0667.149 / Y : 1117.701.
Sa destruction est certainement assez récente. On l’aperçoit encore sur la
carte IGN des années 80/90 et son emplacement est nettement visible sur les
clichés Google Earth de 2003, 2009 et
2011. Cette fois-ci, ce n’est pas une cave, mais un puits qui renferme les
précieuses richesses. Il n’y a aucune trace de ce puits dans la parcelle que
couvrait autrefois le bois.
« De Choisy a Chartronges, au printemps, la
route est agréable (...) au delà des blés en herbe et de l'incarnat des
trèfles, on voit des bois et des prairies qu'entourent des haies vives et de
hauts peupliers ; cette partie s'appelle Grandchamp. Jadis, il y a de cela
longtemps, bien longtemps, à la place de ces prairies, au milieu de ces bois,
qui sans doute s'étendaient beaucoup plus loin, s'élevait un château. Un lettré
des environs vous dira que Grandchamp fut démoli sous Louis XIII, alors que
Richelieu, pour porter le dernier coup à la féodalité, ordonnait de détruire
les forteresses que le moyen-âge avait bâties. Quoi qu'il en soit, il ne reste
plus de ce château que le souvenir. L'histoire des seigneurs qui le possédaient
se perd dans la nuit des temps; on sait seulement qu'ils étaient très cruels.
Le château de Grandchamp devait être, du moins dans les dernières années de son
existence, une façon de Roche-Mauprat ; quiconque s'approchait des fossés
risquait d'être pendu haut et court : il n'y avait d'exception, parait-il, que
pour les habitants de Chartronges. La terreur qu'avaient inspirée les seigneurs
de Grandchamp ne disparut pas avec eux ; elle prit une autre forme. Les
habitants des campagnes environnantes ne tardèrent pas à peupler les lieux où
ils avaient vécu de fantômes et de revenants. Il y a quelques années, on
parlait encore du Diable de Grandchamp et des malheurs survenus aux gens qui
l'avaient vu ; l'Esprit Malin revêtait le corps des animaux de nos bois, et
parfois des plus inoffensifs. Un charretier qui labourait dans la plaine de
Grandchamp vit un renard tourner autour de lui et venir effrontément tout près
de sa charrue ; il ne douta pas que, ce ne fût le Diable, et ses deux chevaux
moururent dans l'année.
Ces récits, entendus aux veillées
d'autrefois, faisaient sur mon âme d'enfant une profonde impression. Je me souviens surtout d'un certain puits,
tout enveloppé de grand mystère, que l’on disait exister dans le bois de Grandchamp,
et j'ai retenu là-dessus une légende qui, dans sa naïveté, m'a semblé jolie.
Ce puits, dont remplacement ne pouvait être
d'ailleurs nettement déterminé, ne s'ouvrait que le dimanche des Rameaux et
seulement pendant la lecture du Grand Evangile. Il renfermait un trésor ;
chacun pouvait, en manquant la messe, aller remplir ses poches : la seule
condition était de commencer par les plus petites monnaies, d'abord les quarts
de sol, puis les pièces de deux liards, et ainsi de suite en montant toujours.
Or, on raconte qu'une femme, était-elle de
Choisy ? Était-elle de Chartronges? céda un jour à la tentation et se rendit à
Grandchamp au lieu d'aller à la messe des Rameaux où l'appelait le carillon des
cloches. Elle avait emporté dans ses bras son enfant, âgé de quelques mois, et,
l'ayant mis à terre, elle ramassait dans son tablier les liards, les demi-sous,
les sous... à pleines poignées. Cependant, là-bas, dans l'église assombrie par
la verdure des buis, le prêtre finissait le récit de la Passion de
Notre-Seigneur. Les ténèbres envahirent le puits, la jeune femme n'eut que le
temps d'en sortir, et dans sa précipitation elle y laissa son enfant. Vous
jugez de son désespoir: elle pleura, elle pria... Mais ses larmes furent vaines
et ses prières restèrent sans réponse : le puits était refermé. Alors, elle fit
le serment de ne pas toucher à l'argent du diable et de le reporter l'année
suivante. Les jours, les mois passèrent. L'hiver vint, puis Pâques refleurit
les buissons et rappela les oiseaux; de nouveau, la pauvre mère se rendit au
bois de Grandchamp. Miracle! L’enfant n'était pas mort: dans le puits ouvert il
lui tendait les bras et, ainsi terminait la bonne vieille qui m'a conté ceci,
il marchait seul ! »(14).
Le dernier
témoignage est celui de Héron de Villefosse. C’est sûrement celui qui est le moins
précis sur la localisation du site(15). C’est
aussi le plus récent. La légende consignée apporte toutefois certaines
précisions absentes des précédentes versions. L’endroit qui abrite le trésor
est à présent un souterrain. Il s’agit peut-être de la galerie dans laquelle le
maire de Chartronges est descendu.
« En
face du bois de Queues-Levées, Grandchamp avait sa légende. Mon père appelait
ce fossé carré, hérissé d'arbustes, une
motte. Les malins savaient que, le dimanche des Rameaux, un souterrain s’ouvrait
au milieu des broussailles, au moment même où le curé de Chartronges commençait
la lecture de l’évangile de la Passion selon Saint-Matthieu. Il fallait alors
se précipiter avec un sac. On traversait successivement une salle pleine de
monnaie de cuivre, une seconde comble de pièces d’argent, et la dernière, bien
sûr, était remplie d’écus d’or. Attention ! … la porte se refermait inexorablement à l’instant même
où le prêtre prononçait Cum custodibus. Impossible ensuite de découvrir une
issue…, d’où tant d’imprudents disparus… »(16).
(1) Pierre
Geslin :
Brie antique: notice sur la topographie gallo-romaine de l'arrondissement de
Coulommiers, Editions Amatteis, 1993, p69 et Férand 1860 : notice sur la
topographie gallo-romaine de Coulommiers, p. 41, notice dactylographiée par le
Docteur Richard en 1983.
(2)
Jean-Noël Griffisch, Danielle Magnan, Daniel
Mordant : Carte
Archéologique de la Gaule, la Seine-et-Marne, Éditions de la Maison des
sciences de l'homme, Paris 2008, p 367.
(4) Tuiles.
(5) Visiblement Geslin n’a
pas daté les amphores qui peuvent être gauloises et/ou gallo-romaines, note de Paul Brunet.
(6)
Jean-Noël Griffisch, Danielle Magnan, Daniel Mordant : Carte
Archéologique de la Gaule, la Seine-et-Marne, Éditions de la Maison des
sciences de l'homme, Paris 2008, p 367/368.
(7) Pierre
Geslin
: Brie antique: notice sur la topographie gallo-romaine de l'arrondissement
de Coulommiers, Editions Amatteis, 1993, p 69.
(8) Pierre
Geslin :
Brie antique: notice sur la topographie gallo-romaine de l'arrondissement de
Coulommiers, Editions Amatteis, 1993, p 69.
(9)
Jean-Noël Griffisch, Danielle Magnan, Daniel Mordant : Carte Archéologique
de la Gaule, la Seine-et-Marne, Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, Paris 2008, p 368.
(10) Voir :
http://www.bdcavite.net/fiche.asp?INIT=on&IDT=IDFAA0050164
(11) Jean-Noël Griffisch, Danielle Magnan, Daniel Mordant : Carte Archéologique
de la Gaule, la Seine-et-Marne, Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, Paris 2008, p 368.
(12) Paul
Brunet :
mail du 20 janvier 2013.
(13)
Joseph Massoul :
Monographie du village de Chartronges, 1881, p32 à 34.
(14) Henri
Menu :
Mélanges, Grandchamp (Légende briarde), Revue de Champagne et de
Brie, 15 avril 1893, Tome 5, p 475/477.
(15) Le Bois des Queues
Levées est situé face aux Grands Ponceaux, de l’autre côté de la
D111, à droite du site décrit par Férand.
(16) René
Héron de Villefosse : L'île de France, Fayard, 1965, p 56.
Canton de Savigny-le-Temple
La vie
aquatique à Savigny-le-Temple/ 1865-2013
On pourra
toujours reprocher à Lecotté ses écarts de localisation, même si certains
relèvent plus de la négligence volontaire que d’autre chose. C’est le cas de la
fontaine Saint-Hilier mentionnée à
deux reprises dans ses Cultes Populaires(1), la première sur
la commune de Lieusaint et la seconde sur celle de Savigny-le-Temple. Ici,
Lecotté ne reproduit pas l’erreur de l’auteur à qui il emprunte ses
informations, mais minimise en quelque sorte les dégâts d’un possible oubli. En
clair : mieux vaut deux fois que pas du tout. Après quelques recherches
effectuées en bibliothèque et auprès de plusieurs personnes de la commune, il
semblerait qu’il n’ait existé qu’une seule source, située sur la commune de
Savigny-le-Temple et connue sous le nom de Puits
ou Fontaine Saint-Hilliers. La confusion vient donc du vicomte de Ponton d’Amécourt
qui, dans un article daté de 1865 la localisait sur celle de Lieusaint. Voyez
plutôt :
« Lieusaint a deux de ces sources, la fontaine
Quintien et la fontaine Saint-Hilier. Saint Quintien est le patron du village,
on s'adresse à lui pour la guérison de certaines épidémies d'enfants; quant à
la fontaine Saint-Hilier, son nom qui a de l'analogie avec heilen, guérir, est
porté par d'autres fontaines sacrées. A Lieusaint, une croix d'exorcisme est
plantée devant cette source, et les fiévreux viennent y attacher leur mal sous
forme de lambeaux d'étoffes, comme font encore à la fontaine de Saint-Fiacre,
près Mimeaux, les personnes atteintes du mal que guérit saint Fiacre »(2).
 |
| L'ARBRE DE LA FONTAINE SAINT-HILIER (SAVIGNY-LE-TEMPLE) |
Cette
fontaine trouvait « sur la route de
Paris à Lyon, non loin de l’endroit où fut commis l’assassinat du courrier de
Lyon en 1865 »(3). Son aspect
et son emplacement exact ne sont plus connus de la population locale, dont la
ville à subit une forte urbanisation, mais en recoupant les différents plans à
disposition, il est possible de rectifier le tir. Le cadastre napoléonien la situe
au point : X : 0618.831 / Y : 1099.645, au bord de la Nationale
6, derrière l’actuel magasin GIFI. Il n’en reste plus aucun vestige
aujourd’hui. Déjà en 1908, Gabriel Leroy prétend que la source est tarie et que
les pèlerinages ont cessé(4). Comme
beaucoup de ses semblables placées sous le patronage d’un saint, elle possédait
des vertus curatives et était réputée pour guérir les fièvres. Un informateur
de Lecotté ajoute également : « Qu’à
la fin du XIXème siècle, les femmes stériles s’y rendaient pour avoir des
enfants »(5). Une troisième
particularité, qui cette fois la replace dans notre contexte mythologique, la
distinguait aussi des autres. Laissons la parole à Ludovic Carrau: « La Fontaine de saint-Hillier guérit la
fièvre et l’on accourt de toutes les parties du pays environnant pour lui
demander santé ; les malades jettent de l’argent dans la source même, qui
passe pour contenir un trésor. Voilà bien tous les caractères des sources
sacrées du paganisme, dîtes-aussi puits à la monnaie… A côté de la source est
un vieil arbre mort, taillé en forme de croix, et toujours, chargé de lambeaux
d’étoffes »(6).
Une dernière
précision : La nouvelle Rue du Puits
Saint-Hillier ne correspond en rien à l’ancien Chemin du Puits de Saint-Hillier dont le départ s’amorçait
autrefois au niveau actuel de la parcelle 1668, à peu près au 2/3 de la Rue Anna Lindh, coordonnées : X
0618.187 / Y : 1097.981, pour rejoindre, presque 2 km plus loin au
nord-est, la nationale 6. On en voit encore deux traces sur le cliché Google
Earth du 31/12/2003, soit quelques années avant que les promoteurs décident
d’investir sérieusement le terrain. Aaaahhhh ! Les bienfaits de
l’urbanisation…
(1)Roger
Lecotté :
Les cultes populaires dans l‘actuel diocèse de Meaux, Mémoires de la
fédération folklorique d'Île-de-France, Paris, 1953, p 165 et 168.
(2) Vicomte Ponton d’Amécourt : Note sur
une médaille rencontrée à Provins, Bulletin de la Société d'archéologie,
sciences, lettres et arts du département de Seine-et-Marne, 1865, p158.
(3 et 4) Gabriel Leroy : Noisement,
Almanach de Seine-et-Marne, 1908, p 125 et 126.
(5) Roger Lecotté : Les cultes populaires dans l‘actuel
diocèse de Meaux, Mémoires de la fédération folklorique d'Île-de-France,
Paris, 1953, p 168.
(6) Ludovic Carrau : L’Origine des
Cultes Primitifs, Revue des Deux Mondes, Mars 1876, troisième quinzaine, p
662.
Canton de Rebais
La cave et
l’ombre d’un pâle évangile
Depuis que Louis-Hubert-Alexandre
Bazin a décrit le Bois de la Grange
à Rebais(1), aux
environs de 1894, celui-ci, a perdu la moitié de sa superficie et ne représente
plus aujourd’hui qu’une langue boisée de 380 sur 140 mètres. Ce qu’il dépeint comme
les vestiges d’un camp retranché Romain, se trouvait alors à l’intérieur de ce
bois. De nos jours, la plus grande partie de ces vestiges se situe en dehors et
a été arasée pour faciliter la culture. Voici l’état des lieux qu’en a fait notre
archiviste vers la fin du XIXème : « Dans l'intérieur du bois, on rencontre un fossé de 6 mètres de largeur
et 4 mètres de profondeur dont les terres sont relevées intérieurement en forme
de cavalier. La surface limitée par ce fossé a la forme d'un carré d'environ
230 mètres de côté. A son extrémité Est (côté de Rebais) existe une mare
circulaire de 15 à 20 mètres de diamètre contenant toujours de l'eau. (…) Sur
le côté Est, mais extérieurement, et dans la partie basse, on a mis à jour, il
y a quelques années, en creusant un fossé, un amas assez considérable de tuiles
paraissant avoir subi l'action du feu. Ces tuiles semblent provenir d'une
construction rurale, une grange, peut-être, établie au moyen âge et détruite au
moment des guerres de religion, car leur forme, ainsi que leur fabrication, est
d'origine relativement moderne. On nous a rapporté cependant qu'on y a trouvé,
au commencement de ce siècle, des chapiteaux et des fûts de colonnes en pierre,
mais nous n'avons pu vérifier le fait. Quoi qu'il en soit, et malgré ce qu'on a
pu dire à l'égard de ce bois, nous ne pensons pas qu'il y ait existé une ville
ou un château-fort quelconque, mais qu'on se trouve en présence, seulement,
d'un camp romain à proximité duquel, et beaucoup plus tard, fut édifiée une
construction rurale »(2).
Pierre
Geslin, qui a visité le site dans les années 1990, précise : « Les fossés profonds avec vestiges de remblai
intérieur existent toujours. Nous venons de les retrouver, près du hameau de la
Boyère. Ils se trouvent à l’intérieur d’un petit bois qui a subi récemment une
coupe sévère. L’enceinte est incomplète. On sent bien que la partie située à
l’est, hors du bois, a été nivelée. On en devine partiellement le tracé. Un
réservoir de rétention de la chocolaterie voisine a, lui aussi, écorné le
retranchement. Les plus beaux fossés se trouvent à l’ouest du bois : 6m de
largeur et environ 2m de profondeur. Le remblai atteint encore 1m d’épaisseur.
De profondes irrégularités du sol, à l’intérieur de l’enceinte, donnent à
penser à une réoccupation médiévale. (…) Un camp antique ? L’enceinte y
ressemble, mais ce n’est pas absolument certain. Des habitants du hameau nous
ont parlé d’une légende locale qui place à cet endroit un château. Comme à
Chartronges »(3).
Plus récemment, Mr Majewski de l’office de Tourisme de
Rebais, m’a rapporté qu’il existait encore quelques restes de fossés dans le
bois, mais qu’ils tendaient à disparaitre. Sur les clichés Google Earth de 2011, on distingue deux fossés : le premier de 170
m d’orientation Est-Ouest, très net, qui part du haut du bois, et son retour Nord-Nord-Ouest-Sud-Sud-Est
suivi sur près de 130m. On aperçoit également un maigre filet parallèle au nord
du fossé Est-Ouest, et une tache quadrangulaire à l’angle des deux fossés. Dans
un cliché de l’IGN du 26-8-1972, que m’a transmit Paul Brunet, on remarque, à
l’est du Bois de la Grange, une tache
foncée qui représente très vraisemblablement la mare de 15 à 20 mètres que
Bazin décrit à l’extrémité Est et contenant toujours de l’eau. En résumé,
« Il existe de nombreux indices sur
les couvertures de l'IGN qui permettent de confirmer les dires de Bazin. En
revanche, comme d'habitude, sans sondage, aucune datation n'est possible »(4).
 |
| CAVE DU BOIS DE LA GRANGE (REBAIS) |
Une légende
de trésor existait à cet endroit. A l’heure actuelle, peu de gens en ont encore
connaissance, pas moins de deux ou trois personnes, m’a confié Mr Majewski. On
doit sa pérennisation à Louis-Hubert-Alexandre Bazin, qui comme beaucoup de ses
confrères de l’époque, faisaient leur boulot jusqu’au bout :
« Depuis peu d'années, le fossé a été comblé sur le côté droit, les défrichements
continuent et dans un temps peu éloigné, ce qui reste de la vieille forêt aura
disparu sous la hache du bûcheron, la charrue fouillera la terre qu'auront
foulée les soldats romains et il ne restera plus de son antique origine que les
légendes mystérieuses au sujet d'une cave que la croyance populaire affirme devoir
y exister. C'est ainsi, qu'à ce sujet, on nous racontait, il y a bientôt 20
ans, que cette cave avait 365 marches (ni plus ni moins), qu'elle renfermait
une suite de chambres contenant : les plus proches des monnaies de bronze, les
autres d'argent et enfin les dernières d'or, mais qu'on ne pouvait se les
procurer qu'à des conditions ridicules ou impossibles à remplir. La cave, nous disait-on,
ne s'ouvre qu'une fois par an, le jour des Rameaux, et on ne peut y descendre
qu'au moment où le prêtre lit le grand Évangile. Mais, une fois entré, il ne
faut pas s'y attarder et malheur à celui que tente l'appât de l'or, car, s'il
n'en sort pas avant la fin de la lecture, la porte se referme, et il devient la
proie du diable qui garde la cave »(5).
(1)
Coordonnées du Bois de la Grange : X : 0665.491 / Y :
1129.922.
(2) Louis-Hubert-Alexandre
Bazin : Le Bois de la Grange à Rebais, Bulletin de la
Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de
Seine-et-Marne, 1894, Volume 10, p 188-189.
(3) Pierre
Geslin : Brie antique: notice sur la topographie gallo-romaine de
l'arrondissement de Coulommiers, Editions Amatteis, 1993, p 89.
(5) Louis-Hubert-Alexandre
Bazin : Le Bois de la Grange à Rebais, Bulletin de la
Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de
Seine-et-Marne, 1894, Volume 10, p 189-190.
Canton de Roissy-en-Brie
De ce que
contient la tour du roi
Sur la commune de Roissy-en-Brie, dans une petite
clairière de la Forêt Régionale de
Ferrières, parcelle 244, au point : X : 0624.827 / Y : 1122.013,
se trouve un petit îlot entouré de fossés remplis d’eau qui forment, à
l’extrémité Nord, une mare, connue sous le nom de Mare du Cormier. Autrefois, il y avait à cet endroit les murs ruinés
d'un bâtiment et les restes d’une tour carrée assez importante. Il n’en reste
rien actuellement. D’après l’Abbé Lebeuf, ces vestiges étaient ceux d’une
demeure ayant appartenue au roi Charles-le-Chauve. Toujours dans cette même enceinte,
il précise qu’un ermitage vit le jour vers 1195, ainsi qu’un oratoire dédié à Notre-Dame du Cormier(1). « Il y avait en ce lieu un petit pèlerinage
très-peu connu, sous le titre de Notre-Dame du Cormier. Il n'était guère visité
que par les habitants de Roissy »(2).
 |
| LA TOUR DE NOTRE-DAME-DU-CORMIER (ROISSY-EN-BRIE) |
Une tradition de trésor merveilleux, localisé
dans les ruines de la tour, était, il y a 250 ans de cela, d’une réalité presque
palpable : « Je pense enfin que
les deux étages de la tour qui subsiste en partie, étaient une espèce de
fortification à la manière de ces temps-là, et un lieu propre à cacher des
trésors. Il s'était formé à Roissy une tradition, qu'il y en avait. On les y a
cherchés, mais sans rien trouver »(3). Je
n’ai pas l’impression que ce soit encore le cas aujourd’hui.
(1)
Abbé Lebeuf : Histoire du diocèse de Paris, Tome 14, Paris, 1758,
p 420/422
(2) Louis de Sivry et M.
Champagnac : Dictionnaire géographique, historique, descriptif,
archéologique des pèlerinages anciens et modernes et des lieux de dévotion les
plus célèbres de l'univers, Tome 2, 1851, Paris, p 519.
(3) Abbé Lebeuf : Histoire
du diocèse de Paris, Tome 14, Paris, 1758, p 421.
















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire